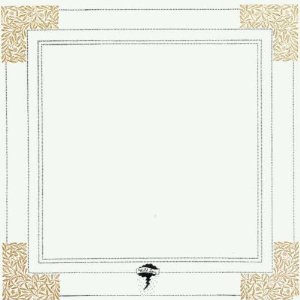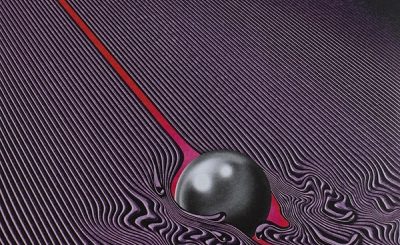Mes années 2010 : 20-11
20. Bill Callahan Spring (2013)
Spring ou le prélude à l’après-midi d’un faune. Rarement aura-t-on entendu un Bill Callahan aussi ouvertement sensuel, la panse gorgée de désir et visiblement agité par une montée de sève printanière. Callahan démontre une fois encore toute la force évocatrice de son art, plantant en quelques mots un décor sauvage et beau qu’il s’empresse d’expédier d’un trait (“Spring looks bad lately anyway”) pour mieux tourner son attention vers ce désir qui l’habite : “And all I want to do / Is to make love to you (…) The true spring is in you”. Toute la chanson ressemble à une eau frémissante, un blues électrique et fiévreux traversée d’une flûte à l’allure baladeuse, touche mutine dans un paysage accablé de chaleur, rêve érotique en terre brûlante. Callahan affiche une décontraction presque guillerette, prenant à l’évidence un plaisir communicatif à se glisser dans les draps de la soul et à se laisser guider par l’appel de la chair pour au final nous offrir un énième chef-d’œuvre.
19. Rihanna & Mikky Ekko Stay (2012)
La star barbadienne s’offrait le temps de ces quatre minutes en suspension – servies sur un plateau par Mikky Ekko, Justin Parker et Elof Loelv (?) – une forme de classique instantanée, ballade bouleversante dont on ne s’est jamais vraiment remis. Loin des excès dommageables plombant trop souvent nombre de ces productions à gros budget, Rihanna habite ici une maison vide, rongée par le désir, le manque et les troubles infinis de la passion qui consume. Un piano, une ligne de basse, quelques effets sonores minimalistes en toile de fond et deux voix à l’unisson, c’est tout ce qu’il faut pour ériger un monument sidérant de beauté intranquille, de fièvre impossible à négocier. Rihanna confirme ses impressionnants talents d’interprète, demeurant d’une justesse infinie tout du long, puissante et fragile à la fois. Le morceau impose à chaque écoute sa sublime gravité, sa profondeur de cathédrale. Repris depuis en beauté par Low ou Cat Power, Stay est un diamant noir.
18. Beach House Troublemaker (2012)
Il est bien question de trouble ici, de trouble et puis de fièvre, de tous les chambardements qui remuent le corps et l’âme, vous gonflent le ventre et vous donnent envie d’exulter, de crier, de pleurer, de fendre l’air avec vos poings, en un mot de vivre plus fort. Sous la brillance multicolore de ces incessants va-et-vient entre guitare et synthé, sous ces lumières de fête foraine et ces spirales tournoyantes à la fascinante beauté, Troublemaker recèle un feu qui semble consumer cette musique de l’intérieur et qui se libère en geyser au moment des refrains, quand Victoria Legrand laisse libre cours à son souffle brûlant, un vent de Sahara chargé tout autant de joie que de mélancolie. Le sommet tempétueux d’un groupe capable comme personne de souffler le chaud et le froid.
17. Sun Kil Moon Dogs (2014)
Véritable Livre des morts de Mark Kozelek, Benji recèle son lot de perles obscures dont je n’ai pas fini de faire le tour. Ce sera finalement ce Dogs impressionnant qui m’aura le plus marqué parmi ces morceaux à haute teneur autobiographique, dans lesquelles Kozelek s’emploie à pousser à son paroxysme ce qu’il n’a cessé de faire depuis les premiers chefs-d’œuvre de Red House Painters : exposer ses tourments pour mieux exorciser les nôtres, se regarder le nombril pour mieux nous dévoiler nos propres profondeurs. Évocation radicalement impudique de la vie amoureuse de son auteur (réelle ou reconstruite), Dogs en dresse un portrait fragmenté, collectant au fil de sa trame chronologique les souvenirs marquants : premières amours, explorations sexuelles imprimées dans la peau, humiliations et lâchetés, manque et insuffisances… Tout y passe, dévidé par un blues obsessif qui n’est pas sans rappeler le génial Nude as the news de Cat Power paru vingt ans plus tôt – et sur lequel on retrouvait également Steve Shelley à la batterie. Plus que la vision d’un homme mûr ressassant à voix haute ses amours passées, Dogs convoque plutôt celle d’un homme essayant d’assembler les pièces de son existence pour en extraire un sens et n’y discernant au final rien qu’un amas de trajectoires croisées, de collisions et de départs. La vie est une indéchiffrable balistique.
16. Arcade Fire The suburbs (2010)
Parus à l’orée de la décennie 2010, The suburbs – l’album autant que le chanson – se sont érigés d’emblée comme autant de classiques instantanés. Le morceau-titre de ce disque toujours aussi passionnant dix ans plus tard demeure lui aussi une épopée fantastique, une captivante aventure faussement immobile et ouverte à tous les horizons. Portée à bout de bras par un tempo guidé par le piano, la chanson se déploie telle une marche en avant, un long travelling traversant la banlieue, géographie intime minée d’ennui et d’espérances et peuplant les rêves et les souvenirs du narrateur. La fièvre et le lyrisme du groupe sont ici contenus mais continuent d’agir en sous-main, un peu à l’image d’une forêt souterraine qui viendrait peu à peu envahir la cité, craquelant les rues et fissurant les trottoirs. Ballade butée progressant sur un fil entre l’espoir et la détresse, The suburbs demeure un formidable fil d’Ariane, un guide au cœur du labyrinthe.
15. Kurt Vile Baby’s arms (2011)
Rarement (jamais ?) autant que sur ce morceau iridescent le musicien de Philadelphie ne se sera ainsi mis à nu, déposant armes et bagages le temps de cette incroyable déclaration d’amour paranoïaque. Berceuse psychédélique et chant d’amour atmosphérique, Baby’s arms est une merveille tremblée, onirique autant que dépressive, qui ne recherche rien d’autre que la consolation face à l’insupportable douleur d’être au monde. Kurt Vile apparaît presque comme un enfant démuni et construit avec ça une sorte de halo chatoyant, une bulle onirique dans laquelle on voudra à son tour pénétrer. Musicalement, Vile délivre une forme de folk subaquatique, parsemé de sonorités étranges qui semblent directement résonner avec nos cordes les plus sensibles. Un véritable palais de verre, toujours à deux doigts de s’effondrer.
14. The Apartments No song no spell no madrigal (2015)
Entame poignante du disque du grand retour de ce héros intime que restera toujours à mes yeux Peter Milton Walsh, No song no spell no madrigal claque comme un coup de fouet et nous frappe comme un uppercut dès les premières notes de basse placées en ouverture. Dès cette incroyable entrée en matière, la chanson se charge d’une impensable intensité qui l’animera durant près de six minutes, ballade tracée au couteau dans les paysages douloureux et pourtant magnifiques composant le décor des chansons de l’Australien. On ne saisit toujours pas bien ce qui se joue ici, cette alchimie unique où se côtoient rage sourde, éternelle tentation de l’abandon et quête perpétuelle de la beauté. On ne saisit pas bien à quoi rattacher cette pop mêlant aussi intimement la soie et les tripes mais on y voit cette fissure qui, en toutes choses, laisse entrer la lumière pour citer (approximativement) Leonard Cohen. Et à côté de cette musique désarmante, de cette voix sans pareille, de ces mots terribles et lumineux, on reste convaincus d’une chose : Peter Walsh ne ressemble à personne et ne semble chanter que pour nous.
The Apartments – No song no spell no madrigal
13. Metronomy The upsetter (2014)
Y a-t-il plus émouvant que la mélancolie moelleuse de The upsetter ? Avec cette chanson toute de délicatesse blessée, le groupe de Joseph Mount touche à son zénith en poursuivant dans la voie d’une pop opulente et dépouillée à la fois. Les guitares sont ici sans conteste la grande affaire de la chanson : guitare acoustique qui mène le morceau avec une nonchalance rêveuse et surtout, cette guitare électrique à l’ineffable beauté qui entre en scène autour de 2 minutes 40. Cette dernière entame un solo à la grâce sans pareille, un des plus touchants qu’il m’ait été donné d’entendre, et qui prend doucement la tangente par rapport à la ligne originale du morceau. De ces notes contemplatives s’échappe une douce tristesse proprement bouleversante, tapis flottant au-dessus de nos têtes comme une nouvelle Voie Lactée.
12. Bill Callahan Summer painter (2013)
Sur ce chef-d’œuvre minéral et tempétueux qu’est Dream river, Summer painter scintille comme un diamant noir, un monolithe anthracite paraissant déchaîner autour de lui les intempéries puis intimer le calme aux cieux. Le morceau épouse à merveille la personnalité mystérieuse de son narrateur, figure mutique et inquiétante à laquelle les habitants finissent par prêter des pouvoirs paranormaux. Callahan travaille une fois de plus le personnage de l’outsider, ici peintre de bâteaux qui se pare peu à peu des atours du sorcier. Summer painter avance à couvert, rampant sous un tamis instrumental tout de tension retenue qui finalement se déverse tel l’orage à partir de trois minutes vingt : l’atmosphère semble se raréfier, les nuages noirs comme le charbon obscurcissent l’horizon et la pluie s’abat en trombes sur la ville. Puis le calme revient (“then came a quiet no one should know”) et le temps reprend son cours.
Bill Callahan – Summer painter
11. Deerhunter Desire lines (2010)
On pourra trouver assez savoureux que ce morceau, sans doute le plus emblématique du groupe de Bradford Cox, soit à mettre au crédit du guitariste Lockett Pundt. L’anecdote démontre a minima à quel point Deerhunter est loin d’être le seul véhicule de la psyché tourmentée de Cox mais le plus important tient bien dans le fait de tenir ici une chanson proprement exceptionnelle, dont chaque écoute constitue un plaisir renouvelé et un nouvel embarquement pour une odyssée sidérante. Desire lines débute pourtant sans payer de mine, un agréable morceau d’indie-pop brumeuse aux inclinations shoegaze. La chanson gagne progressivement en ampleur et tout bascule à partir de trois minutes, quand les guitares de Cox et Pundt transforment la chanson en portail dimensionnel et donnent à l’auditeur l’impression qu’il va bientôt entrer dans l’hyper-espace. Ces plus de trois minutes trente de guitares tournoyantes, exaltantes, fascinantes et bien plus encore vous feront voir des couleurs qui n’existent pas et feront défiler le paysage comme à travers les vitres d’un train lancé à vive allure. Le monde est flou, le monde est beau et tout va vite. On conseillera vivement l’écoute de nuit sur l’autoroute.