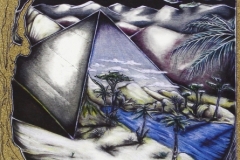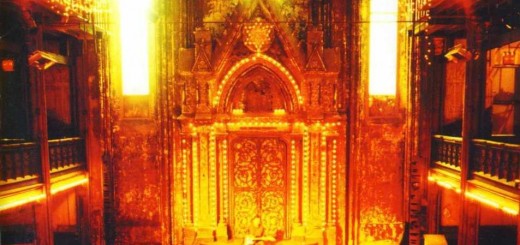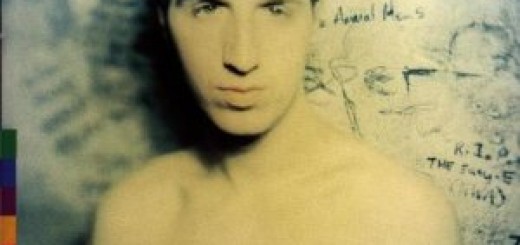Mes années 2010 : 80-71
80. Gil Scott-Heron I’ll take care of you (2010)
En sus de réveiller le fantôme de Robert Johnson (cf. supra), Gil Scott-Heron offrait sur son album I’m new here une relecture somptueuse de ce titre devenu classique composé par Brook Benton et interprété par Bobby Bland en 1959. Scott-Heron tamise encore les teintes bleu nuit de l’original et en livre une version vibrante et dépouillée. Un piano solitaire conduit le morceau sur fond de discrètes nappes synthétiques tandis que la rythmique marque un battement feutré. Quelques notes de violon en pizzicato semblent tomber comme des gouttes de nuit et le chant cabossé de Scott-Heron s’élève tel une prière cendrée. Émane de l’ensemble une bouleversante humanité, rassemblant tendresse, compassion et abandon pour donner corps à une grande chanson d’amour et de dévotion.
Gil Scott-Heron – I’ll take care of you
79. Yo La Tengo Ohm (2013)
Même si les années 2010 ne resteront probablement pas la décennie la plus marquante du groupe, Yo La Tengo demeure une évidente valeur sûre, ne descendant jamais en-dessous d’un certain niveau de qualité et toujours capable de coups d’éclat roboratifs. Ce titre qui ouvre l’album Fade de 2013 en constitue une excellente illustration, condensant quelques-uns des plus brillants atouts du trio d’Hoboken. Porté par la rythmique presque sautillante maintenue tout du long par Georgia Hubley, Ohm tourne autour d’un riff hypnotique qui finit par provoquer l’échauffement général de la chanson, un peu suivant le principe de l’effet bobine. En parcourant la structure spirale du morceau, l’électricité insufflée par la guitare d’Ira Kaplan gagne en intensité et finit par générer une euphorie communicative. Les accents fatalistes un brin désabusés des paroles sont ainsi contrebalancés par l’énergie déployée qui fait au final d’Ohm un hymne à la résilience et à la persévérance.
78. Jonathan Wilson Desert raven (2011)
Quatrième (et dernière) occurrence du grand Américain dans ce classement, Desert raven demeure ma petite préférée sur ce disque épique qu’est le Gentle spirit du bonhomme. Épique pourrait d’ailleurs sans conteste qualifier ce morceau qui déroule durant près de huit minutes son entrelacs de riffs électriques et acoustiques et semble célébrer la rencontre inspirée entre le Pink Floyd 70’s et David Crosby. Cette cavalcade folk psychédélique constitue le véhicule idéal pour le trip panthéiste de Jonathan Wilson, qui fait miroiter sous nos yeux ébahis le désert, les corbeaux, les étoiles en un grand patchwork de couleurs et de sensations. L’atout maître de la chanson réside dans le groove imparable que le bonhomme insuffle à l’ensemble, nous faisant découvrir une nouvelle façon de planer sans jamais stagner. La grande classe.
Jonathan Wilson – Desert raven
77. Low Clarence White (2013)
Évocation trouble (et évidemment non explicite vu le peu d’appétence du combo pour la littéralité) d’une ancienne légende de la guitare country-rock, accompagnateur – entre autres – des Byrds ou de Gram Parsons, Clarence White démontre la formidable capacité du groupe d’Alan Sparhawk et Mimi Parker à bâtir une dramatique magistrale sans appuyer sur les effets. Bien aidée ici par la production limpide du grand Jeff Tweedy (Wilco), la chanson affiche ce fascinant mélange de tension et de lenteur propre à la formation du Minnesota. Le morceau progresse à la façon du froid qui saisit les membres un à un, faisant peu à peu ployer l’auditeur sous le joug de l’intensité qu’il dégage. Piano, guitare et batterie bâtissent une construction d’une densité folle, dont il semble impossible de vouloir s’échapper. Et quand Sparhawk chante “I know I shouldn’t be afraid”, la force de son auto-persuasion ne suffit pas à nous extraire de ce dédale psychotique à la beauté pourtant sidérante.
76. Hollie Cook 99 (2014)
Deuxième morceau de l’excellent deuxième album de la Londonienne Hollie Cook, 99 ne cesse d’éblouir par la grâce des savants mélanges qu’il distille. Un ensemble de cordes frémissantes et intenses se greffe à la décontraction d’un tempo reggae patelin tandis qu’une mélodie collante évoque le pépiement d’un oiseau tropical. Au final, le tout dégage une mélancolie profonde et néanmoins jamais ramenarde, la lune qui se reflète sur la surface des eaux paraissant en appeler davantage au naufrage intime qu’à la baignade. Le chant de la miss charrie une tristesse insondable sans le moindre pathos, comme s’il flottait au-dessus d’un bonheur qu’elle sait déjà disparu. Le résultat s’avère en tout cas aussi addictif que souterrainement bouleversant.
75. The War On Drugs Red eyes (2014)
La musique du groupe d’Adam Granduciel n’a cessé au fil de la décennie écoulée de gagner en ampleur et de raffermir la puissance de sa force motrice. Peu de morceaux le symbolise autant que ce génial Red eyes, titre-phare de Lost in the dream, l’album de la consécration pour le groupe de Philadelphie. Baignée du meilleur du lyrisme héroïque de Springsteen, Red eyes trace sa route droit devant, traversant la pluie, le vent et les éclaircies qui agitent autant les conditions extérieures que la psyché du chanteur. Claviers, rythmique et guitares glorieuses avancent avec une compacité admirable, menés à la baguette par un Granduciel comme possédé, dont le “woo” balancé à 1’49 demeurera un des grands moments de grâce de la musique de ce début de siècle.
74. The Innocence Mission Green bus (2018)
Je n’ai pas encore pris le temps de m’intéresser de très près à la discographie pourtant fort riche – pas loin de 15 albums parus depuis 1989 – de ce trio originaire de Lancaster, Pennsylvanie. Depuis que je suis monté dans ce Green bus, extrait de l’album Sun on the square, j’avoue avoir du mal à en descendre et à porter mon attention sur d’autres morceaux du groupe. Tout ici enchante et invite à une sorte d’immobilité scintillante : de l’acoustique finement ourlée de la guitare aux arrangements de cordes soyeux en passant par la voix cristalline de Karen Peris. La chanson est une sorte de merveilleux moment suspendu, comme une pensée vaguement esquissée, une rêverie passagère et pourtant prégnante, un paysage seulement entrevu à travers les vitres du bus et laissant au cœur une impression indélébile. Karen Peris chante : “I cannot find a thing beautiful enough for you” mais on sait, pour notre part, qu’elle nous a déjà offert un trésor inestimable.
The Innocence Mission – Green bus
73. Sharon Van Etten Serpents (2012)
Sur son Tramp tourmenté et tendu, l’Américaine posait ce morceau au souffle ravageur, condensé de rage balancé à la face du monde en guise de règlement de comptes avec une ancienne relation destructrice. Pour porter cette chanson brûlante et si intime, Van Etten s’adjoint paradoxalement les services de nombreux porte-faix, comme si elle avait besoin de l’aide d’un commando d’artificiers pour régler au plus fin la mire de sa colère. Outre la contribution majeure de Aaron “The National” Dessner, on retrouve ainsi aux côtés de la dame Julianna Barwick, un Walkmen, un Wye Oak et le frère d’Aaron Dessner, Bryce. Pas si loin de certains coups de semonce autrefois envoyés par PJ Harvey ou Lauren Hoffman, le morceau déploie un rock carré et racé, percutant comme un direct au foie, de celui toujours capable de procurer les grands frissons et de nourrir les grands brasiers.
72. Frank Ocean Ivy (2016)
Probable que cette chanson se serait classée plus haut si j’avais arrêté cette sélection plus tard, tant elle semble s’être immiscée dans chaque recoin de mon cerveau depuis sa découverte (très tardive). Mon attention a mis du temps avant de se porter sur Frank Ocean mais le coup de foudre avec Ivy fut immédiat dès la première écoute de Blonde, ce qui est peu fréquent chez moi. C’est sans doute parce qu’Ivy se rapproche davantage d’un morceau indie-rock que d’un standard rap ou R&B… Construit sur une suite d’accords flottants joués à la guitare et soutenue par une ligne de basse aussi discrète qu’essentielle, Ivy pourrait s’assimiler à une page arrachée d’un journal intime, Frank Ocean paraissant se remémorer une histoire ancienne et douloureuse. Se dégage de l’ensemble une nostalgie poignante, la voix d’Ocean progressant comme une onde autour de cet écheveau fragile et fracassé. Au final, la chanson semble s’ouvrir tel un trou noir sur la psyché du bonhomme, mettant à nu d’imposantes et bouleversantes fêlures.
71. Bill Callahan Drover (2011)
Au fil de la décennie écoulée, Bill Callahan a peu à peu acquis la stature d’une sorte de figure tutélaire de l’indie-rock US, bâtissant album après album une œuvre d’une ampleur peu commune dans le paysage musical actuel. Placé en ouverture de son Apocalypse de 2011, ce morceau démontre la force et la classe hors catégorie du songwriting du bonhomme. Avec cette histoire (rêvée ?) de garçon vacher dont le cheptel finit par lui échapper, Callahan expose tout ce qui fait la singularité de son art et ce qui le rend si précieux : ces histoires pleines de trous que l’auditeur peut choisir (ou non) de remplir à sa guise, cette voix d’une présence rare et pourtant toujours un peu ailleurs et puis cette musique puisant aux sources intarissables du folk-rock US pour en tirer une sorte de quintessence grave et mystérieuse, d’une grande subtilité sous ses abords un peu bruts. Ici, Callahan se fait presque morriconien, en tout cas dans l’atmosphère qu’il bâtit autour d’un riff répétitif de guitare acoustique gratté en profondeur. Un violon, une flûte et quelques éclats électriques tracent des lignes de fuite et l’auditeur voit défiler sous ses yeux les chemins caillouteux, la poussière en suspension sur fond de paysage rocheux, les sabots du bétail, l’air troublé par la chaleur… Un chef-d’œuvre de plus pour Callahan, qui a pourtant fait encore mieux (on le verra plus haut) au cours de la décennie.