Mes années 2010 : 90-81
90. Beach House Take care (2010)
Final éblouissant de beauté de leur génial Teen dream, Take care s’avère avec le temps un des titres les plus émouvants du répertoire du duo. Autour d’un motif mélodique tissé au clavier, le morceau se déploie et enfle pour atteindre une intensité magnifique et décoller loin au-dessus du sol, usant de cette fascinante dynamique aérienne (qu’on pourrait même qualifier de pneumatique) qui est devenue la signature du groupe à son meilleur. Mélancolique sans être dépressif, lyrique mais sans esbroufe, Take care sème derrière lui une traînée de poussière d’étoile et semble ne plus vouloir finir, Victoria Legrand répétant tel un mantra “I’ll take care of you, take care of you, it’s true” en fin de morceau, comme une promesse, un engagement, un acte de foi.
89. Jonathan Wilson Magic everywhere (2011)
Pic – mais pas point culminant – d’un album qui n’en manque pas, Magic everywhere est un des morceaux les plus impressionnants d’un disque qui ne cesse de plonger corps et âme dans le fleuve musical du folk-rock US made in Laurel Canyon pour en ramener les secrets d’une jouvence éternelle. Le morceau débute en ballade chuchotée, qui gagne progressivement en ampleur, quelque part entre David Crosby et Gene Clark. Puis, autour de deux minutes vingt, la chanson prend véritablement la tangente, comme si elle décidait de quitter la route pour aller s’ébrouer dans les plaines infinies de l’Ouest américain, portée par un solo de guitare acoustique parti en éclaireur. Parfaitement raccord avec la mythologie du Canyon, le morceau déploie une imagerie panthéiste, invitant à laisser nos corps derrière nous pour célébrer la magie qui nous entoure. On en ressortira converti et chancelant.
Jonathan Wilson – Magic everywhere
88. Deerhunter He would have laughed (2010)
Autre grand disque de la décennie, déjà représenté plus bas et qui sera représenté plus haut, Halcyon digest de Deerhunter se clôt sur ce titre à la beauté fantomatique, hommage hanté à Jay Reatard, musicien indie décédé au tout début de l’année 2010. Au milieu d’un paysage musical diffracté, scintillant comme les rayons du soleil perçant à travers les frondaisons d’un bois, s’élève le chant bouleversant de Bradford Cox qui enchaîne des sentences troubles et marquantes. A partir de quatre minutes trente, le morceau mute en une sorte de ballade folk lessivée, Cox continuant de livrer les lambeaux d’une tirade déchirante (“Where did my friends go ?”) et la musique semblant s’évaporer peu à peu dans une lueur brumeuse. Cox conclut le morceau par un “Shut your mouth” qui n’appelle aucun commentaire, l’auditeur en demeurant bouche bée et la larme à l’œil.
Deerhunter – He would have laughed
87. Kevin Morby Drunk and on a star (2016)
Sur Singing saw, Kevin Morby apportait une ampleur orchestrale nouvelle à son déjà excellent répertoire folk-rock qu’il dispensait depuis son Harlem river de 2013. Avec cette ballade superlative, le New-yorkais d’adoption s’en va chercher des noises à quelques-uns des meilleurs artisans d’un folk-rock mâtiné de pop, de Josh Rouse aux divins Lambchop. Un ensemble de cordes vient consteller le plafond d’un millier d’étoiles et Morby prend ici des airs de Pierrot assis sur son croissant de lune et contemplant, un brin d’herbe au bord des lèvres, la magnificence de la nuit s’étendant sous ses pieds. Et la rencontre entre cette instrumentation soyeuse et la rusticité traînarde du chant de Kevin Morby ne fait que rehausser le charme coruscant du morceau.
Kevin Morby – Drunk and on a star
86. Allah-Las Catamaran (2012)
Le premier album des Allah-Las – et une bonne partie de leur discographie ultérieure – demeure un excellent moyen d’ensoleiller ses journées et de faire le plein de vitamine D sans risque pour la peau. Ce Catamaran qui ouvre ce premier album sans titre constitue un des morceaux les plus cools et exaltants de ces dernières années, petit bijou euphorisant ondulant au gré d’une accroche mélodique imparable qu’on sifflotera en chœur à chaque écoute. Le chant tout en décontraction de Miles Michaud constitue un atout supplémentaire, autant que le tapis d’orgue Hammond déroulé sous la coque du morceau par un Nick Waterhouse œuvrant également à la production. Au final, on se rêve volontiers donnant congé aux fâcheuses et aux fâcheux en reprenant l’entame du morceau : “Out on the water, is where you’re gonna find me”. Vers le large, sous le soleil exactement.
85. Real Estate Out of tune (2011)
Avec son air de ne pas y toucher, le groupe du New Jersey (un de plus – coucou les Feelies, coucou Yo La Tengo) s’est affirmé comme un fidèle compagnon de nos humeurs incertaines, un chantre lumineux de la douceur mélancolique. Sur son deuxième album, Days, Out of tune est sans doute le morceau le plus emblématique, avec ses entrelacs de guitares en cascades, son halo de nonchalance rêveuse, sa tiédeur enveloppante. Real Estate emprunte surtout le pont suspendu reliant les arpèges aériens des Byrds au psychédélisme glorieux des Stone Roses, raccordant Los Angeles et Manchester sur fond de légère brume. Une magnifique chanson de mi-saison.
84. LCD Soundsystem Dance yrself clean (2010)
Incroyable morceau d’ouverture de ce qui fût l’album de la première fin du groupe de James Murphy, Dance yrself clean se déploie tout d’abord sous les atours d’une retenue vaguement menaçante, une lente spirale tournant autour d’une boucle percussive servant d’appui à un texte aux relents paranoïaques qu’un sample de flûte vient parasiter autour des deux minutes. Puis au bout de trois minutes, la chanson semble littéralement propulsée sur le dance-floor par une sorte de déflagration sonore, comme si James Murphy avait décidé de passer aux choses sérieuses en poussant le volume à fond. L’auditeur esbaudi se retrouve alors à son tour embarqué dans cette folle sarabande, tandis que la chanson se dérègle peu à peu entre synthés dissonants et le chant de chaman cabossé de Murphy. Euphorique, suant et débraillé, le morceau finit par s’échouer au bout de neuf minutes de transe jouissive, dans les odeurs de bière et d’animal, les yeux remplis d’étoiles et de fatigue.
LCD Soundsystem – Dance yrself clean
83. Metronomy Everything goes my way (2011)
Disque de la révélation pour le groupe de Joseph Mount, The English riviera contient son lot de pépites pop sophistiquées aux mélodies accroche-cœurs. Everything goes my way est une des mes préférées, avec ses handclaps, sa ligne de guitare voltigeuse, ses petits “pouëts” au saxophone et cette forme d’échange à deux voix entre Mount et Roxanne Clifford, autant d’atouts qui me la rendent si précieuse. Le morceau s’avère surtout enchanteur par son mélange de simplicité et de subtilité, ses manières de bon élève rêveur, dessinant des nuages dans son cahier d’écolier. On n’oubliera pas de mentionner l’apport unique des parties chorales, qui ne cessent de clignoter et de rebondir dans nos canaux auditifs, pour nous tournebouler l’esprit et le cœur comme la plus délicieuse des addictions.
Metronomy – Everything goes my way
82. Kanye West Blame game (2010)
S’appuyant sur une ligne de piano chipée chez Aphex Twin et s’adjoignant les services de John Legend et de l’acteur Chris Rock (pour un final délirant), Kanye West livre ici un morceau fascinant, entre romantisme blessé, morgue méprisante et humour malade. Aux passages chantés par John Legend d’une voix sucrée, Kanye West répond par des couplets rappés dressant l’inventaire sans faux semblants de l’échec d’une relation, très probablement sa relation avec la modèle Amber Rose. “Yeezie” endosse tour à tour les diverses postures de l’amoureux blessé, tantôt pétri de regrets, tantôt empli d’une amertume vindicative. Le portrait de cette relation destructrice peut aussi s’écouter comme une métaphore de la relation tumultueuse de Kanye West avec la célébrité, celle-ci affectant une santé mentale que l’on sait précaire. Dans la lignée de son chef-d’œuvre dépressif 808s and heartbreak, on retrouve sur Blame game un Kanye West entouré de papillons bleus, mais le morceau se distingue par l’intervention finale de Chris Rock pour un monologue à la fois amusant et malaisant, d’une vulgarité crasse et dont l’outrance ajoute à la désorientation ressentie par l’auditeur. Au final, Blame game se révèle la radiographie sans fard des grandeurs et des bassesses d’un cœur meurtri.
81. Sufjan Stevens Vesuvius (2010)
Je suis loin d’avoir fait le tour de ce disque gargantuesque qu’est The age of adz, chef-d’œuvre fracassé délivré par l’immense Sufjan Stevens à l’orée de la décennie écoulée. Disque incroyablement intimidant, The age of adz révèle autant de beautés impensables que de chausse-trapes, autant d’arcs-en-ciel que de crevasses. Huitième chapitre de ce voyage éprouvant et fascinant, Vesuvius, à partir d’une entame dépouillée au piano, se déplie “en rhizome” (pour reprendre la si juste expression du bloggeur Old Claude dans sa chronique du disque) pour se transformer en construction complexe, grouillante et débordante. Du fait du titre du morceau, impossible de ne pas se figurer un paysage fracturé et bouillonnant, un territoire volcanique à la beauté brute et implacable à la fois, dans lequel l’acoustique initiale est peu à peu parasitée par une électronique invasive et foisonnante, tandis qu’un ensemble de chœurs quasi psychotiques vient faire tanguer le morceau dangereusement. Et au milieu de ce chaos, le chant fluet de Sufjan Stevens fait office de boussole, d’instrument nécessaire pour conserver le cap et veiller à ne jamais sombrer.
















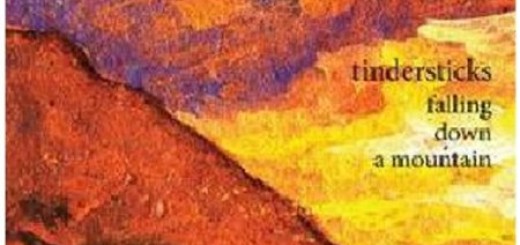



Merci beaucoup de m’avoir cité dans ta belle chronique de Vesuvius de Sufjan Stevens, le type même de disque que tu ne peux pas prétendre connaître sans l’avoir écouté pendant des dizaines d’heures, ce qui est une discipline à laquelle la plupart des auditeurs refusent de se soumettre.
Merci beaucoup pour le commentaire. Je retourne le compliment sur la qualité de ta chronique. Nulle doute que tu attendras aussi le prochain LP du sieur Stevens annoncé pour la rentrée.