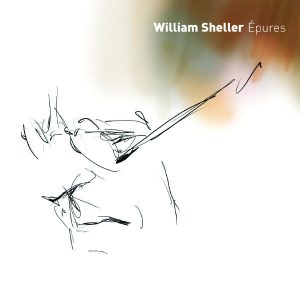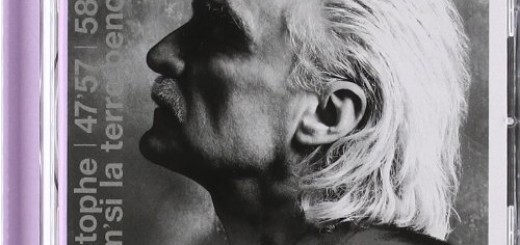La solitude du pianiste
William Sheller Épures (2004, Mercury)
En mettant les mains sur ce disque, je me suis souvenu que ma fréquentation de la musique de William Sheller remontait à déjà loin. Je devais avoir en effet onze ou douze ans quand j’ai – ou plus vraisemblablement quand on m’a – acheté Le nouveau monde en 45 tours. J’imagine d’ailleurs que ce devait être mon premier contact ou presque avec la musique orchestrale. Je n’ai jamais depuis pris le temps de me pencher plus avant sur la discographie du bonhomme mais quelques-unes de ses chansons me trottaient régulièrement dans la tête, pour la finesse de leur mélodies et cette humble mélancolie qui semblait les habiter, de l’imparable Un homme heureux aux Filles de l’aurore. Ces Épures m’intriguaient donc depuis quelque temps que je les voyais à la bibliothèque où j’ai mes habitudes et, comme d’habitude, je me suis rendu à ma curiosité.
Vous allez me dire mais je ne peux pas vous croire / Que c’est tout simplement qu’elle ne veut plus me voir / Même si c’est vrai parfois qu’elle est presque trop belle / Voici son visage ne l’oubliez plus / Si vous la voyez au hasard de vos rues / Dites-lui donc au besoin qu’un jour elle m’appelle
Toutes les choses qu’on lui donne
Au début de la magnifique Toutes les choses qu’on lui donne, William Sheller chante qu’il n’est “là qu’au hasard d’un bien curieux parcours” ; curieux parcours en effet que celui du bonhomme. Ayant passé sa petite enfance dans l’Ohio, il rentre en France pour être élevé par une famille de théâtreux et finit par nourrir dès ses 10 ans l’ambition de devenir compositeur classique. Détourné de la voix qui le menait droit au prix de Rome par les Beatles, le jeune homme se retrouvera finalement poussé par Barbara à devenir chanteur. C’est une chanson-gag, Rock ‘n’ dollars qui lui vaudra le succès à son corps défendant et de se retrouver assimilé à une variété française frelatée dont il s’extraira bien vite pour se consacrer à son goût pour la composition sous toutes ses formes. Au fil des années, il se promènera ainsi au fil des ans de la musique symphonique au rock, en passant par les expérimentations électroniques tout en gardant le bon goût de semer derrière lui quelques chansons de belle facture au-dessus du tout-venant de la chanson d’ici.
Vers les lumières oranges / Les gens ça les dérange / Que je ne sache pas auquel ressembler / Vous aviez l’air étrange / Des yeux de mauvais ange / Que je ne peux plus oublier
Machines absurdes
Sur Épures, William Sheller renoue avec la formule de son plus grand succès, cet assemblage piano-voix qui faisait la beauté précieuse de Un homme heureux et de son triomphal En solitaire. Enregistrés chez lui sur son propre instrument, les douze morceaux figurant sur ce (court) album creusent un registre résolument intimiste dont le dépouillement ne masque nullement la beauté. Et s’il utilise des tonalités mélancoliques, Sheller joue avec suffisamment de subtilité des possibilités offertes par son piano pour que l’homogénéité de l’ensemble ne passe pas pour une grise uniformité. Au contraire, les chansons parviennent à transformer l’environnement domestique dans lequel le bonhomme évolue en de multiples décors, le plus souvent baignés de solitude et hantés par les fantômes des amours enfuies. Sheller donne ainsi à voir de façon très cinématographique la chambre et les mornes ruelles de Mon hôtel ou la rue qui abrite le voyeurisme masochiste et secret de l’amoureux en peine du sublime Loulou. Les personnages mis en scène par William Sheller ont dans leurs cœurs l’empreinte des absences avec lesquels ils composent en se voilant la face (Toutes les choses qu’on lui donne) ou en choisissant le départ (Revenir bientôt). En plus des mélodies, Sheller se révèle par ailleurs un parolier inspiré, ciselant des textes brillant d’un simple éclat, qui s’embrasent parfois en une drôle de poésie hallucinée (le fiévreux Elvira). Entre ses chansons, Sheller a de plus la délicatesse de glisser trois instrumentaux lumineux, qu’on imagine volontiers joués par un des Esseintes reclus dans son domaine, caressant sa solitude comme l’ivoire de son piano.
Je vais sous la pluie qui nourrit le monde / Et se perd dans les ruisseaux / J’entends les histoires du tonnerre qui gronde / Et pleure le long des arbres hauts
Revenir bientôt
Au final, la grosse demie-heure passée en compagnie de ces chansons plus consolantes que pesantes s’écoule un peu suspendue et on se dit qu’on avait bien raison de réserver à William Sheller une place à part dans le monde de la chanson d’ici.