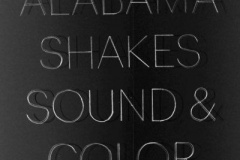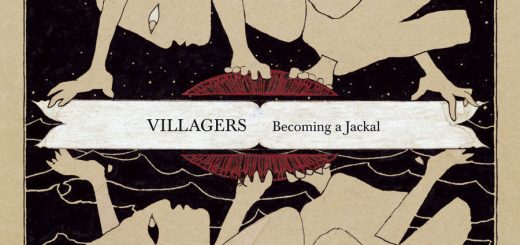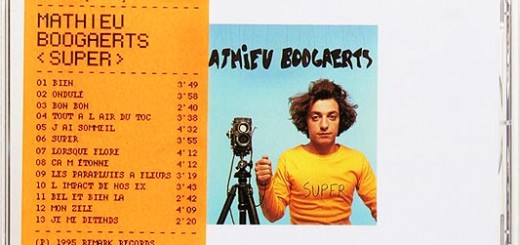Mes années 2010 : 40-31
40. Metronomy The look (2011)
Avec The look, le groupe de Joseph Mount s’offrait un tube réjouissant et réussissait à placer sa petite musique mélancolique en rotation intensive sur les ondes et les pistes de danse. Grâce à un riff de synthé furieusement addictif, la chanson s’incruste en profondeur dans nos cerveaux et y déploie un éventail multicolore de trouvailles mélodiques ingénues et ingénieuses. Tout s’assemble sous nos yeux à la manière d’une mécanique de haute précision arrangée par un Démiurge maniaque et rêveur, procédant davantage par soustraction que par amoncellement. Ce minimalisme rigoriste laisse ouvert un formidable champ des possibles et grave dans nos oreilles son lot de moments jouissifs, de ces notes de guitare qui tombent dans un timing parfait à cette entrée en scène miraculeuse d’une bordée de chœurs au bout de deux minutes.
39. Kanye West Hell of a life (2010)
Morceau le plus impressionnant de son gargantuesque My beautiful dark twisted fantasy de 2010, Hell of a life nous embarque dans une cavalcade furieuse, chargée de fièvre et de stupre. Évocation acerbe de sa relation avec la mannequin Amber Rose autant que fantasmagorie vulgaire mettant en scène son mariage imaginaire avec une actrice porno, Hell of a life est un délire azimuté trépidant et effrayant, comme un judas ouvert sur la psyché fracturée de Kanye West. Bâti sur les plans du “Iron man” de Black Sabbath, Hell of a life embrasse la noirceur un brin carnavalesque de ce heavy metal enfumé et dévale à tombeau ouvert sur un riff de clavier qui se consume tel une guirlande de soufre. Malaisant et sidérant.
38. David Bowie Lazarus (2016)
Difficile de détacher ce fantastique morceau de son contexte et de faire abstraction de tout ce qu’il paraissait annoncer. On a beaucoup glosé sur l’éventuelle dimension prophétique de la chanson tant Lazarus regorge d’indices qui pourraient en faire le dernier chant d’un condamné. Beaucoup y verront une énième mise en scène de lui-même par cet incroyable recycleur autophage qu’était David Bowie. Nul doute que le bonhomme se serait délecté de laisser derrière lui ce mystère de plus mais Lazarus est à lui seul une formidable chanson, inquiétante et intranquille, zébrée de stridences et peuplée d’ombres folles, intimidante et exposant pourtant plus crûment que souvent les fêlures de Bowie. On pourra bien l’interpréter comme l’annonce de la fin qui arrive, c’est bien de cela dont il s’agit. Celle de Bowie ou pas, peu importe ; Lazarus confirme en tout cas que sa présence n’a pas fini de nous hanter.
37. The Apartments Looking for another town (2015)
Avec No song no spell no madrigal, l’indispensable Peter Milton Walsh signait sans conteste le come-back le plus bouleversant de la décennie écoulée, alignant un chef-d’œuvre de plus dans une discographie sans la moindre fausse note. Ce merveilleux Looking for another town constitue une preuve supplémentaire de la grâce sans nom de cette musique. Sans avoir l’air d’y toucher, Peter Walsh fait lentement tournoyer autour de lui une orchestration raffinée qui s’élève pour atteindre des sommets émotionnels d’une intensité folle. La tessiture unique du chant de Peter Walsh lui confère une proximité poignante et la chanson reprend les thématiques habituelles de l’Australien : la perte, le poids du passé, les échecs et les départs, la résilience et la beauté toujours à préserver, comme la bougie qui tremble dans l’obscurité. Quand la voix de Natacha Penot vient doubler celle de Peter Walsh, cette unisson touche au sublime et rappelle une fois de plus combien cet homme qui n’a que la musique à opposer aux douleurs du monde est un géant. On le retrouvera plus haut.
The Apartments – Looking for another town
36. Courtney Barnett Depreston (2015)
Loin du rock ébouriffé et des textes pleins de piquant de ses morceaux les plus roboratifs, Depreston raconte la quête d’un couple pour un logement dans une banlieue sans charme, dont l’Australienne croque la banalité suintante avec un sens de l’observation d’une rare acuité. Cette lente dérive aux accents springsteeniens, dont le riff s’inspire de l’immortel Streets of your town de ses compatriotes des Go-Betweens, se transforme progressivement en réflexion introspective sur la vie, la mort et le temps qui passe, sans le moindre prêchi-prêcha mais avec au contraire une humilité très émouvante. Mêlant trottoirs sales et ciel étoilé, le trivial et le métaphysique, Depreston s’élève avec la force de l’évidence au rang de classique instantané.
35. Feist The circle married the line (2011)
Mes fidèles lecteurs et lectrices savent déjà tout de mon amour immodéré pour Metals, quatrième album hors catégorie de la Canadienne Leslie Feist. The circle married the line expose ici le versant le plus lumineux des talents d’orfèvre de cette songwriter hors pair. Grande chanson de pop sans collier, The circle married the line célèbre le jour qui se lève, l’aube embrasant l’horizon et plus généralement, la quête d’un espace ouvert aux quatre vents, à l’extérieur comme à l’intérieur de soi. La Canadienne use d’une orchestration soyeuse pour déverrouiller portes et fenêtres et laisser entrer l’air en grandes brassées. L’ensemble paraît alors se jouer de la pesanteur et l’auditeur croit voir voleter devant ses yeux oiseaux et papillons – peut-être même des fées – dans une lumière éclatante. Une inspiration ô combien précieuse dans l’atmosphère étouffante des temps présents.
Feist – The circle married the line
34. Radiohead Daydreaming (2016)
“I’m not here / This isn’t happening” chantait déjà Thom Yorke seize ans plus tôt sur le prodigieux How to disappear completely. Daydreaming s’inscrit dans cette même esthétique de l’effacement, tant le morceau semble tout du long vouloir se dissoudre dans l’espace qui entoure chacune des notes d’un piano à la douceur inquiète. Daydreaming traverse l’auditeur comme une ombre spectrale, laissant derrière lui une trace cryptique dont on chercherait en vain à percer le mystère. Cette musique de peu recouvre d’insolentes richesses : une mélancolie traversée d’espérance, une forme de sidération atone et les fantômes de quelques grandes figures du monde du silence, Mark Hollis en tête.
33. Purple Mountains I loved being my mother’s son (2019)
Vous vous apercevrez peut-être que pas mal des chansons constituant ce classement traitent de la mort, de la perte ou du deuil. Il faut croire qu’avançant en âge, la question commence à me tarauder sérieusement ou alors que les artistes que j’apprécie se trouvent forcément de plus en plus confrontés à cette inéluctable épreuve qui accompagne leur propre vieillissement. Hommage forcément bouleversant à sa mère disparue en 2014, I loved being my mother’s son relève la gageure de recouvrir une insondable tristesse d’un halo de lumière, baignant d’un amour et d’une tendresse infinis la douleur du deuil. La trame mélodique nimbée de country scintille comme la Voie Lactée et devant ce mur d’étoiles, la voix grave de Berman laisse entrevoir de béantes fêlures. On reste terrassé par la vision de cet homme désespérément seul, enfant perdu hébété face au vide qui l’entoure.
Purple Mountains – I loved being my mother’s son
32. Alabama Shakes Gimme all your love (2015)
Le quatuor atomique atteint ici une forme d’acmé électrisante et passionnelle, avec cette ballade gorgée de soul, de désir inassouvi et d’urgence amoureuse. Le morceau vaut évidemment pour l’interprétation volcanique d’une Brittany Howard plus brûlante que jamais mais Gimme all your love vaut aussi par la dynamique de balancier de sa structure musicale. Féline et tendue, la chanson prend d’abord la forme d’un slow inflammable, qui finalement s’embrase de façon spectaculaire autour de 2’20 pour laisser libre cours à une furia endiablée. L’ensemble est aussi intense que classieux, le groupe parvenant à sculpter un son brut et chiadé à tomber. Le feu au cul, le feu au cœur, le cœur au bord des lèvres…
Alabama Shakes – Gimme all your love
31. Villagers Hot scary summer (2015)
Sommet d’un album qui n’en manque pas, Hot scary summer témoigne de tout ce qui rend l’art de Conor Oberst si précieux. L’homme-orchestre des Villagers livre ici une chanson d’une beauté sans égale, vibrante de justesse et d’intensité. Avec l’humilité des grands maîtres, Oberst atteint un mélange de force et de simplicité qui confère à la chanson une évidence désarmante. Hot scary summer s’élève comme une prière païenne invitant à la communion, sous un habillage instrumental sobre et pourtant éclatant. Oberst crée avec l’auditeur un singulier sentiment de proximité, et n’hésite pas incidemment à aborder sans détour l’homophobie au fil d’un couplet. Le morceau dépeint un paysage intérieur d’après-rupture : la tempête est passée, plus rien ne sera jamais pareil, tout est sens dessus dessous mais il faut bien accepter sa nouvelle gueule, bardée de cicatrices. On pourrait même essayer d’en être fier.