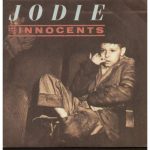Mes amours francophones : 180-171
180. TTC Dans le club (2004)
Loin d’être fin connaisseur de la scène hip-hop nationale – ou internationale d’ailleurs – , j’aurais peine à précisément estimer la place qu’a pu y occuper TTC. Plusieurs indices – dont le documentaire ci-dessous – me laisse à penser que leur originalité était réelle et que leur singularité demeure encore remarquable. A mon échelle, leur Bâtards sensibles de 2004 avait tout d’un OVNI et la claque infligée par Dans le club rougit encore mes joues. Les trois lascars conduisent ici une impitoyable razzia, semblant surfer sur une vague de sons électro prête à déferler sur la piste de danse. Tour à tour drôles et vulgaires, alternant prétention et auto-dérision, les TTC livrent une sorte d’hymne tordu, brouillé par les stroboscopes et pétri de désorientation déglinguée. Tout tourne, et le morceau épouse à merveille le rythme décousu de certaines soirées, entre confusion des sens et perception embrumée.
- Dans le club
- Et aussi : Ebisu rendez-vous
- Bonus : sur cette scène un peu fourre-tout dite du rap alternatif, un petit documentaire assez éclairant pour les béotiens (comme moi) : Un jour peut-être
179. Programme Boomerang (2000)
Après avoir passé le rock français à la sulfateuse avec Diabologum au milieu des années 1990, Arnaud Michniak et Michel Cloup poursuivirent séparément leurs chemins d’artificiers. Le premier – en collusion avec Damien Bétous – dégoupillait dès l’entame du millénaire un véritable disque-brûlot sous le nom de Programme avec Mon cerveau dans ma bouche, sur lequel ce Boomerang rougeoyait – parmi d’autres chansons hautement inflammables – avec une intensité particulière. Sur ce morceau, Michniak slamme un texte sans concession sur un chaos entremêlant boucles de guitares électriques, piano percussif et rythmique convulsive. A la croisée du rock, du hip-hop et du jazz, Programme nouait autour de nos cous cette chanson étranglée, rageuse et inventive, s’affirmant alors comme une des expériences les plus explosives de la musique d’ici.
- Boomerang
- Et aussi : Demain
- Bonus : un hommage à Arnaud Michniak
178. Bertrand Belin Plonge (2013)
Bertrand Belin s’est imposé au fil des années comme un des plus passionnants orfèvres des musiques francophones. J’ai déjà eu plusieurs fois l’occasion d’exprimer dans ses pages tout le bien que je pensais de son travail, notamment son somptueux Parcs de 2013, magnifiquement baigné de la lumière du jour. Parmi les hauts faits d’un disque qui n’en manque pas, Plonge brille d’un éclat particulier, déployant ses charmes avec une forme de lenteur majestueuse proprement fascinante. Entre les mains de Bertrand Belin, la simple observation d’un plongeur acquiert une dimension inattendue, révélant par là-même la capacité du bonhomme à dévoiler la profondeur des choses d’apparence anodine. Tel celui qui hésite à se jeter à l’eau, Plonge compte précisément le moindre de ses mouvements et semble évoluer dans une sorte d’entre-deux, en équilibre sur la ligne de flottaison. Tout respire le plein air, l’atmosphère brouillée par le soleil et les épidermes mouillés. Et la diction si particulière de Bertrand Belin renforce encore l’attente de savoir si oui ou non, le plongeur fera le pas décisif pour se lancer hors de la planche.
- Plonge
- Et aussi : Peggy
- Bonus : Entretien avec Bertrand Belin par l’impeccable Rebecca Manzoni dans Eclectik du 26/05/2013
177. Patrick Coutin J’aime… regarder les filles (1981)
En 1981, cet ex-journaliste rock s’en allait décrocher un tube monumental avec ce condensé brûlant de mâle frustration. Patrick Coutin réussissait par la même occasion à faire entonner à la France entière une ritournelle obsédée et obsédante, zébrée de guitares salaces sur lesquelles un homme en chaleur criait à sa manière : « I can’t get no satisfaction ». Portée par une ligne de basse balancée comme les courbes ici reluquées, J’aime… regarder les filles s’échauffe progressivement comme une cocotte-minute pour finir dans un nuage de vapeurs chaudes. Le morceau suscitera les hauts cris de la France frigide et sera écarté des grandes ondes mais profitera de la vague libératrice des radios libres pour aller émoustiller un très large public. Le succès sera tel qu’il recouvrira à jamais la discographie ultérieure du bonhomme, écrasée par cette chanson-monstre.
- J’aime… regarder les filles
- Et aussi : parmi les innombrables reprises et relectures de ce morceau, en voici une (pas dégueulasse) d’un certain Bertrand Belin
- Bonus : une excellente interview de Patrick Coutin parue en 2013 dans le magazine Gonzaï
176. Les Wampas Danser sur U2 (2006)
Bon, j’avoue, je ne connais pas grand chose aux Wampas puisque j’ai dû à tout casser écouter un album et demi du groupe. Cet album et demi m’aura néanmoins suffi pour nourrir une vraie sympathie pour l’incomparable Didier Wampas et aussi me rendre compte qu’outre son image de parrain punk déglingué, le bonhomme était capable de composer de remarquables chansons, bien plus fines que sa réputation (méritée) de grande gueule déjantée. Les vrais fans auraient sans doute choisi un titre plus énergique, plus emblématique de la musique des Wampas mais mon petit cœur d’artichaut ne s’est jamais vraiment remis de ce morceau tendre et drôle, mais surtout drôlement tendre. Je n’y entends aucun second degré – ou si peu -, juste une immense bienveillance et une forme d’innocence au cœur brisé (comme la voix de Didier Wampas) réellement émouvante. Bienveillance pour ceux-là qui dansent sur U2 sous les yeux du narrateur du morceau, et bienveillance pour ce même narrateur, qui aimerait lui aussi toucher un instant du doigt ce bonheur simple de serrer quelqu’un contre lui, sur U2, devant un film pourri ou n’importe où. « Être aimé, bon sang, être aimé » ou l’éternel chant de ralliement des esseulés et qui traverse sous tant de formes des centaines et des centaines de chansons adorées.
- Danser sur U2
- Et aussi : Manu Chao
- Bonus : Les Wampas en concert au Trabendo au moment de la sortie de Rock ‘n’ roll part 9 (2006)
175. Florent Marchet Où étais-tu ? (2014)
Pièce maîtresse de l’impressionnante odyssée cosmique qu’est son Bambi galaxy de 2014, cet Où étais-tu ? accusateur déploie son foisonnant canevas électro-pop au fil de l’avancée d’une implacable rythmique. Crépitant comme un compteur Geiger, mêlant MGMT et Sébastien Tellier, le morceau progresse inexorablement, loin de la structure traditionnelle couplet-refrain, et atteint une ampleur étourdissante. Laissant derrière lui le « tu » auquel il s’adresse autant que ses anciennes peaux, le narrateur parvient à des territoires neufs, plaines galactiques et champs stellaires, d’une indicible beauté, les chœurs terminaux illustrant parfaitement cette sorte d’apothéose. L’univers est devant.
- Où étais-tu ?
- Et aussi : Apollo 21
- Bonus : Florent Marchet en interview dans Les Inrocks à l’occasion de la sortie de Bambi galaxy
174. JP Nataf Jean-Philippe (2004)
Durant la longue césure qui marqua la carrière des Innocents, JP Nataf fit paraître deux disques solo en tous points remarquables, dont plusieurs morceaux figurent dans le présent classement. Sur son formidable premier album, Plus de sucre, paru en 2004, on trouve ainsi cet étincelant Jean-Philippe, bijou faussement naïf et d’une richesse discrète. Sous forme d’auto-portrait fragmenté dont lui seul détient toutes les clés (« Innocent, tout blanc, je jouais naguère, des airs d’apprentis »), la chanson s’élance à travers champ derrière un piano et une guitare en bois tendre puis une cohorte d’instruments se joint au cortège pour sérieusement en perturber la trajectoire. La ballade bucolique prend alors des ramifications nouvelles, des teintes multicolores que n’épargne pas l’ombre de la mélancolie et atteint au final une profondeur de champ au départ insoupçonnée. Bien aidé par quelques sûrs renforts (Albin de la Simone ou Bertrand Bonello), JP Nataf provoque ici – et sur tout cet album chaudement recommandé – de bien renversants tremblements intimes.
- Jean-Philippe
- Et aussi : Tout doux
- Bonus : Interview de JP Nataf en 2004 sur le webzine Indiepoprock
173. Arnaud Fleurent-Didier France Culture (2010)
J’ignore comment vieillira La reproduction, l’album de la révélation de cet alors trentenaire parisien au début de cette décennie mais, dix ans après, France Culture demeure toujours une sacrée bonne chanson. En à peine plus de trois minutes, Arnaud Fleurent-Didier dresse le bouleversant inventaire des failles d’un héritage, des béances de la transmission dans une famille qu’on imagine volontiers plutôt bourgeoise. En choisissant d’insister sur tout ce qui lui manque, Fleurent-Didier trace un (auto?) portrait en creux proprement saisissant, emballé dans un habillage musical de première classe, allant chercher du côté des grands maîtres pop seventies, de Polnareff à Gainsbourg en passant par John Barry. Fleurent-Didier parvient même à tirer profit de ses limites vocales, en choisissant une forme de chanté-parlé le plaçant à distance de son sujet et amplifiant cette impression de relevé implacable des carences d’une filiation.
- France Culture
- Et aussi : Reproductions
- Bonus : comme quoi Arnaud Fleurent-Didier était loin de faire l’unanimité, une critique toute en méchanceté de l’excellent Stéphane Deschamps dans Les Inrocks.
172. Brigitte Bardot Moi je joue (1964)
Souvent sous-estimée hors les chansons que lui composa Gainsbourg, la discographie de Brigitte Bardot vaut pourtant qu’on y jette plus qu’une oreille distraite. Au milieu du grand tumulte que furent pour elle les années 60, l’ex-égérie de la France des Trente Glorieuses voyait la chanson comme une récréation, un bol d’air gagné sur la chape de plomb d’une étouffante notoriété. Outre Gainsbourg, c’est le duo formé de Gérard Bourgeois et Jean-Max Rivière qui offrit à la dame quelques uns de ses titres les plus fameux, comme La Madrague, Je danse donc je suis et ce réjouissant Moi je joue. Collant parfaitement à son personnage et ses aspirations de femme libérée et scandaleuse, Moi je joue et ses espagnolades de guitare échevelées donne à entendre une Bardot jouissant d’être maîtresse des jeux de la séduction et s’amusant – entre feinte cruauté et vraie malice – de son malheureux (enfin, façon de parler) prétendant. La chanson donne au final un aperçu d’une folle légèreté du souffle séditieux que Bardot fit passer sur les moeurs engoncées de la France gaulliste, et les râles de plaisir qu’elle laisse échapper à la fin du morceau font un bien joli doigt d’honneur aux puritains.
- Moi je joue
- Et aussi : Une histoire de plage
- Bonus : découvrir le méconnu Jean-Max Rivière à travers ce Tour de chant de Martin Pénet sur France Musique du 08/10/2017
171. Les Innocents Jodie (1987)
Je me rends compte seulement maintenant que j’aurai suivi le parcours des Innocents depuis leurs débuts. Jodie fut en effet un de mes premiers 45 tours et une chanson dont je ne me suis pas encore lassé. Malgré une production un brin datée, chaque écoute de ce morceau qui lança la belle carrière d’un des groupes les plus dignes d’intérêt de la pop d’ici continue de faire vibrer quelques cordes sensibles. Entre euphorie et mélancolie, appel du large et appel de la raison, les Innocents se révélaient au monde avec une chanson brillant comme un « phare dans la nuit » pour reprendre l’expression très juste d’un autre blogueur musical. Jodie possède une forme d’aura adolescente ineffaçable, l’attrait des ailleurs auquel chacun et chacune d’entre nous aura plus ou moins cédé, a minima en franchissant dans ce mélange d’exaltation et de frousse les portes de l’âge adulte. « Tu descends là, Jodie », et on s’est tous demandé si la vie sera plus belle hors du train.
- Jodie
- Et aussi : Saint Sylvestre
- Bonus : qui était l’actrice interprétant Jodie dans le fameux clip ?