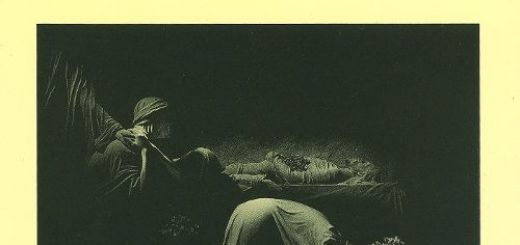Calme blanc
Yo La Tengo And then nothing turned itself inside out (2000, Matador)
Je continuerai aujourd’hui mon parcours aléatoire au sein de l’abondante discographie de Yo La Tengo, avec ce neuvième album officiel du groupe paru en 2000, le troisième que j’aborde dans ces pages. Dix ans après le lumineux Fakebook, le trio d’Hoboken, New Jersey (comme les Feelies), mené par Ira Kaplan et Georgia Hubley continue à démontrer un éclectisme impeccable et une propension réjouissante à se trouver là où on ne l’attend pas.
And then nothing turned itself inside out frappe d’abord par sa grande homogénéité de ton, par la cohérence de sa texture. L’album se déroule quasi-intégralement dans une atmosphère étonnamment calme, la grande majorité des morceaux se déployant avec langueur dans les teintes pastel. Kaplan délaisse le plus souvent les guitares pour les claviers, et la basse semble envelopper la plupart des morceaux dans un cocon ouaté. Kaplan et Hubley alternent comme toujours les parties chantées, le timbre de cette dernière ressemblant de plus en plus à celui de Maureen Tucker du Velvet Underground. Pour autant, Yo La Tengo réussit à ne pas faire de ce disque monochrome un disque ennuyeux ; bien au contraire, l’auditeur est frappé par la richesse du nuancier déployé par le groupe. Entre l’inquiétude et la sérénité, Yo La Tengo se balade entre différents états d’âme avec une suprême élégance, traitant avec finesse et légèreté des intermittences de nos cœurs et des petites fêlures qui ne cicatrisent jamais vraiment. Hubley et Kaplan se livrent ainsi à une forme de ping-pong intime dont on sort tout chamboulé.
L’album s’ouvre avec l’inquiétante reptation de Everyday, morceau empli d’une hébétude menaçante: “When Monday comes I want nothing / Come Tuesday morning I want the same”. On retrouve cette teinte intranquille avec l’étonnant Saturday, fascinante machinerie bringuebalante qui trace quand même sa route sans coup férir. Comme je le disais plus haut, l’ensemble du disque est extrêmement cohérent, et il est aussi difficile d’en pointer un moment faible qu’un acmé évident, chacune des chansons venant tour à tour se coller à nos humeurs et prendre la place de favorite. On retiendra le groove charmant de Let’s save Tony Orlando’s house ou le magnifique et émouvant Last days of disco, d’une rare justesse de ton dans la description douce-amère d’une rencontre amoureuse (“And the song said “Let’s be happy” / I was happy”). On mentionnera aussi la pop ensoleillée de You can have it all ou la splendeur de Madeline, qui n’aurait pas dépareillé sur le sublime Fakebook. Difficile aussi de passer sous silence, tant ce morceau jure avec le ton de l’ensemble, l’enflammé Cherry chapstick, sur lequel Kaplan rebranche les amplis et se livre à un furieux sabbat rock électrique, rempli de frustration adolescente.
Ainsi, en poursuivant ma découverte de l’œuvre de Yo La Tengo, je m’aperçois au fil des disques que l’on tient ici un groupe majeur, traçant sa route dans un relatif anonymat mais acquérant peu à peu une imposante stature, proche de celle d’un Sonic Youth. Je continuerai donc avec bonheur à creuser le filon…