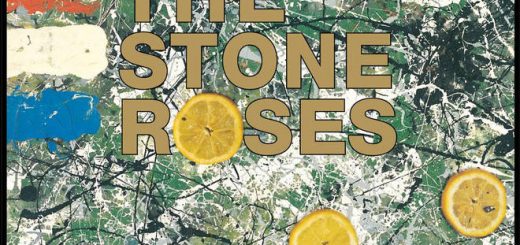De l’orage dans l’air
The Cure S/T (2004, I Am / Geffen)

J’avais jusqu’à présent abordé au gré de ces pages la discographie de Cure dans un ordre strictement chronologique mais je ferai ce soir une exception en me penchant sur cet album éponyme paru en 2004 et qui tourne sur ma platine depuis quelques semaines.
On avait laissé The Cure quatre ans plus tôt sur un Bloodflowers d’une sépulcrale beauté, sur lequel le groupe semblait progressivement s’enfoncer dans un nuage de brume dont on se demandait s’il allait ressortir. On savait que Robert Smith faisait depuis plusieurs années déjà de chaque nouvel opus de sa créature son chant du cygne, point final putatif d’une aventure hors normes qui paraissait dévorer autant que nourrir son sombre héros. On ne savait donc pas vraiment (comme souvent) à quoi s’attendre avec ce treizième album du groupe et Robert Smith réussit ma foi un fort joli contre-pied, brutal et explosif.
Après le lent effilochage de Bloodflowers qui le rendait parfois excessivement diaphane, Smith opère un spectaculaire renversement de tendance, livrant un disque compact et abrasif comme rarement. The Cure aura pour ce faire accepté de bouleverser sa routine, délaissant son label historique pour Geffen, s’adjoignant les services d’un producteur d’ordinaire au chevet de groupes metal comme Slipknot ou Korn, Ross Robinson, et enregistrant les douze morceaux de l’album dans les conditions du direct. Au final, The Cure fait l’effet d’un salutaire coup de tabac dans la coiffure toujours en pétard de Robert Smith et dans les oreilles de ses auditeurs admiratifs.
The Cure remise ici les à-plats de claviers au second plan et laisse de côté les volutes de guitare aquatiques qui faisaient la substance de Bloodflowers pour remettre en avant des sonorités plus rêches, transformant parfois le groupe en émule de Sonic Youth (The end of the world) ou en concurrent de haut vol du meilleur des Smashing Pumpkins. The Cure confère également des contours oubliés au chant de Robert Smith, empli de bruit et de fureur au point de rappeler les grandes heures incandescentes du monstre Pornography (toutes proportions gardées cependant). Le disque comporte donc son lot de pics abrupts et d’imposantes constructions toutes en rugosités, de l’inaugural et ascensionnel Lost au vortex époustouflant de Labyrinth. Un Us or them très politique (diatribe anti-Bush ?) donne à entendre un Robert Smith proprement furibard tandis que The promise s’élève en un crescendo sonique de rouge et d’orage. The Cure n’oublie pas pour autant son savoir-faire pop mais lui donne là encore des contours plus tranchants, sur Before three, The end of the world ou Taking off. L’album se conclut sur un Going nowhere plus proche des beautés cotonneuses de Bloodflowers.
Avec The Cure, Robert Smith renoue l’espace d’un album avec l’énergie fiévreuse qui innerve les meilleurs pans de la discographie de son groupe légendaire, s’offrant un salutaire coup de jeune alors qu’il pourrait se contenter de vivre paisiblement de ses rentes et sortir un disque poussif à intervalles réguliers pour renflouer son compte en banque. J’ignore si ce regain s’est poursuivi avec 4:13 dream, dernier album en date de Cure paru en 2008 que je n’ai pas encore pris le temps d’écouter.