Lumières
Richard & Linda Thompson I want to see the bright lights tonight (1974, Island)
Quand paraît I want to see the bright lights tonight, Richard Thompson n’a que 25 ans mais affiche déjà un imposant pedigree. Membre originel de Fairport Convention, qui entreprit à la fin des années 1960 un formidable ravalement de la façade du folk britannique pour donner naissance à un authentique folk-rock anglais, Thompson sème dès cette époque son lot de pépites au fil de la discographie du groupe. Outre ses compositions, son jeu de guitare hors normes brille aussi de mille feux. En 1971, insatisfait de l’orientation de plus en plus traditionnelle du groupe et estimant que ses compositions ne trouvent plus place dans son répertoire, Richard Thompson se lance en solo. En 1972, il fait paraître Henry the human fly, disque que je ne connais pas mais qui serait la plus mauvaise vente de l’histoire du label Warner. Il rencontre Linda Peters, chanteuse folk écossaise, lors d’une tournée commune et l’épouse. A l’écoute de cet album éblouissant, c’est peu de dire que ce mariage fit des étincelles.
Je pourrais me contenter de dire que I want to see the bright lights tonight est un chef-d’œuvre indépassable, m’arrêter là et vous recommander vivement l’acquisition du disque – ou son téléchargement si vous préférez. J’essaierai quand même de me fouler davantage et de mettre quelques mots sur ces chansons magistrales, tout en demeurant conscient de leur impossibilité à exprimer ce qui se joue ici. Richard Thompson continue d’œuvrer dans un registre folk-rock mais en finit avec les ambiances parfois un peu trop vaporeuses de Fairport Convention. Si l’inspiration de la musique celtique traditionnelle se fait sentir (parfois fortement), Thompson bouscule cette tradition en la mariant à l’esprit mauvais d’un rock à guitare tranchant comme une lame. Le résultat est un disque fascinant de beauté brute, impressionnant condensé de rage et d’élégance, de puissance et de grâce, de colère et de mélancolie. La guitare de Thompson semble sourdre tout au long de l’album, pour mieux jaillir brièvement en éruptions rageuses d’une éphémère beauté. Le graphisme en lettres de sang de la pochette vient attester que l’on ne rigole pas beaucoup sur ce disque-là, Thompson se révélant un parolier magnifique mais d’un pessimisme souvent aigu. Il crée pour la voix de Linda toute une galerie de personnages que celle-ci endosse avec une facilité stupéfiante, de l’amoureuse délaissée de Withered and died à la mendiante narquoise de Little beggar girl.
Ce disque d’un noir d’encre s’ouvre en tout cas par un trait de lumière avec When I get to the border. Thompson se peint avec une joie rageuse et triomphante en desperado en route pour la frontière, laissant sans regrets derrière lui une vie et un passé qu’il ne souhaite que voir mourir (“If you see a box a pine / With a name that looks like mine / Just say I drowned in a barrel of wine / When I get to the border”). Alors qu’on pourrait disserter sur la nature de cette frontière (territoriale? métaphysique?), Thompson livre surtout un morceau d’une force peu commune, se payant d’un coda magistral dans lequel cornemuse, concertina et guitare électrique se répondent et se défient en un ballet étourdissant. La voix de Linda n’apparaît qu’au troisième morceau, ce bouleversant Withered and died, dans lequel une amoureuse délaissée s’en vient pleurer ses rêves brisés. C’est simple et beau à pleurer, comme les plus belles ballades country: “Then I struck up with a boy from the West / Played run and hide, played run and hide / Count one to ten and he’s gone with the rest / My dreams have withered and died”. Le chant de Linda relève la tête avec le morceau éponyme, Thompson décrivant avec une justesse parfaite le besoin des gens simples, assommés par un quotidien morose, d’aller se griser aux lumières des centres-villes une fois le week-end arrivé: “Meet me at the station don’t be late / I need to spend some money and it just won’t wait / Take me to the dance and hold me tight / I want to see the bright lights tonight”. Down when the drunkards roll figure ensuite le contre-point sombre d’I want to see the bright lights tonight : là la lourdeur de l’ivresse a succédé aux joies de la griserie, les cœurs sont tristes et les femmes se vendent au coin des rues. Après une triplette de chansons de haute tenue (dont l’inestimable Has he got a friend for me), Thompson place en fin d’album deux morceaux pour lesquels n’importe quel apprenti songwriter vendrait ses deux mains s’il n’en avait rien que l’idée. D’abord The end of the rainbow, chanson d’un pessimisme dévastateur, écrite à la naissance du premier enfant du couple et qui vient saborder avec une violence impensable tout l’espoir qui peut se porter aux abords d’un berceau: “Life seems so rosy in the cradle / But I’ll be a friend I’ll tell you what’s in store / There’s nothing at the end of the rainbow / There’s nothing to grow up for anymore”. Les larmes perlent à la fin du morceau et notre cœur tourneboulé est submergé par la deuxième vague, The great Valerio, sorte de morceau définitif sur la futilité de la condition humaine (rien que ça) transcendée par la voix de pythie de Linda Thompson. Dit comme ça, ça peut rebuter mais il est difficile de décrire ce titre glaçant comme la fatalité vers lequel, pauvre masochiste, on revient cependant fréquemment.
Le couple enregistrera par la suite six autres albums, parmi lesquels je ne connais que le dernier, l’excellent Shoot out the lights (1982) qui marquera la fin de leur mariage. Richard Thompson poursuit depuis son chemin, s’étant fendu d’une bonne vingtaine d’albums. Je n’ai là encore pas eu l’occasion de les écouter tous, mais chacune de mes retrouvailles avec le bonhomme a valu le coup, de Mirror blue (1994) à Front parlour ballads (2005). Les lumières n’ont pas cessé de briller…
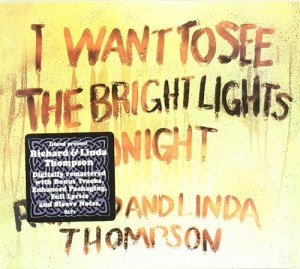

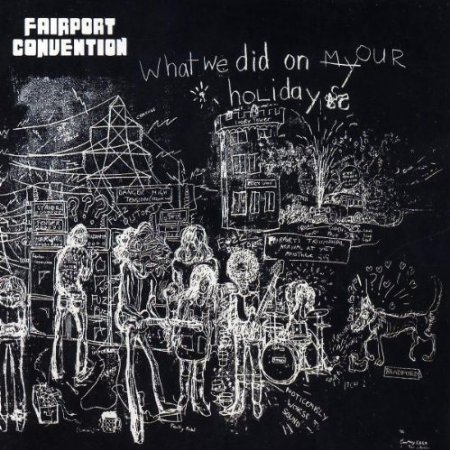
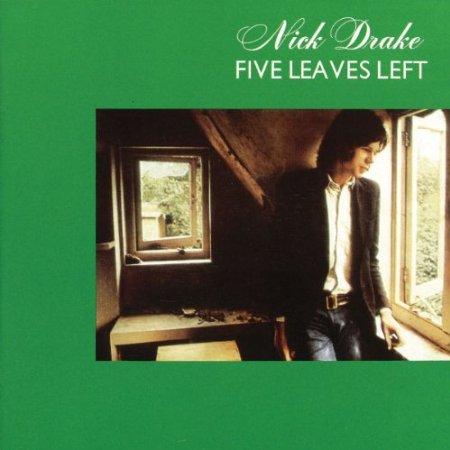






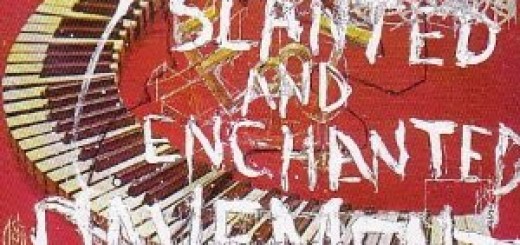
1 réponse
[…] la discographie du grand Richard Thompson ont peu ou prou suivi ce schéma-là et alors que son I want to see the bright lights tonight de 1974 est depuis longtemps un de mes disques de chevet, une bonne partie de ses albums me demeure […]