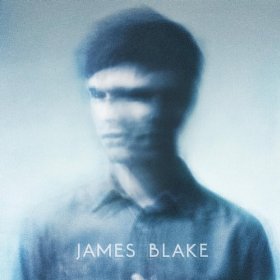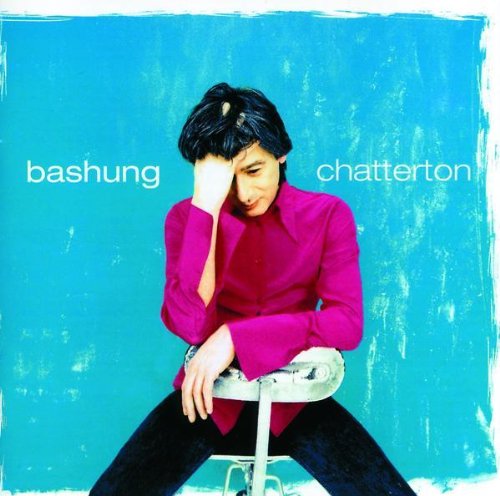Une voix dans la brume
James Blake James Blake (2011, A&M / Universal)
Je ne sais plus guère comment j’en suis arrivé à écouter James Blake. Après l’avoir brièvement confondu avec James Blunt (honte à moi !) et avoir écarté la possibilité d’une reconversion musicale de l’ex-tennisman du même nom, j’ai cru un moment qu’il s’agissait d’un énième chanteur de pop pour teen-agers ou un faiseur de R&B commercial. Il m’aura donc fallu du temps pour cerner à quelle sphère musicale le jeune homme pouvait bien se rattacher, quels étaient ses territoires et ses lignes de fuite. Son “affiliation” à une scène dubstep à laquelle je ne connais quasiment rien n’aurait de surcroît pas forcément du me conduire vers les chansons du jeune Anglais mais finalement, si ma pente musicale me pousse plutôt vers le rock et la pop sous leurs multiples déclinaisons, ma curiosité est – je l’espère – un poil moins bornée. Elle ne m’aura en tout cas pas déçu dans le cas présent tant ce disque, malgré ses imperfections, peut se révéler hanté et hantant.
My brother and my sister don’t speak to me / But I don’t blame them
I never learnt to share
Compte tenu de mes (très) maigres connaissances en matière de dubstep (et de musiques électroniques en général), j’aurais bien entendu tendance à rapprocher James Blake de la musique de Burial, même si les puristes crieront peut-être au blasphème. J’y retrouve les mêmes contours incertains, les mêmes paysages brumeux zébrés de lumière diaphane, les mêmes lignes floues comme l’est le visage de James Blake sur la pochette du disque. J’y retrouve aussi cette forme de mélancolie poisseuse mâtinée d’onirisme et nourrie d’isolement urbain. Mais là où Burial est sans doute plus radical dans son propos, on sent que James Blake trouve aussi ses influences dans un songwriting pop-rock plus classique, lui l’admirateur de Joni Mitchell ou de Feist.
There’s a limit to your love / Like a waterfall in slow motion / Like a map with no ocean / There’s a limit to your love
Limit to your love
James Blake se situe ainsi dans un fascinant entre-deux, invitant les fantômes de Billie Holiday ou de Nina Simone à venir parasiter son électronica rêveuse, transformant les clubs en piano bar perclus de nuit et de solitude. Entre ses rythmiques syncopées et ses voix trafiquées au Vocodeur, l’Anglais fait surtout rentrer du souffle et du silence, de l’émotion et de l’introspection. La répétition de phrases de chant et de motifs sonores confèrent à des morceaux comme The Wilhelm scream, To care (like you) ou I never learnt to share une dimension fascinante, tant cette voix sortie de la brume semble évoluer sur un fil, toujours au bord de la chute, entre un effondrement et une élévation. Sur ce dernier titre, on perçoit même les réminiscences (toutes proportions gardées) des intouchables paysages mouvants dessinés par Robert Wyatt. Give me my month ou Why don’t you call me sont presque plus proches du lyrisme dépouillé d’Antony & the Johnsons mais c’est bien sur l’extraordinaire reprise de Feist, Limit to your love, que ce premier album de James Blake atteint ses plus hauts sommets, suspendant littéralement l’auditeur à chacun des battements de son cœur et livrant un immense morceau de soul qui transcende la pourtant excellente version originale. On regrettera juste les quelques longueurs qui plombent un brin le disque en son milieu (le diptyque Lindisfarne) et rendent certains morceaux bien trop dispensables, mais on pardonnera aisément au jeune homme pour les beautés qu’il a pu produire par ailleurs.
I never told her where the fear comes from
Give me my month
Ce premier album remarquable valut à son auteur une excellente reconnaissance critique et une nomination au Mercury Prize. James Blake a fait paraître depuis un deuxième opus l’année dernière, Overgrown, que j’ai prévu d’écouter très vite, porté notamment par l’impressionnant single Retrograde. Nul doute que le jeune homme n’a sans doute pas encore livré tous ses secrets.