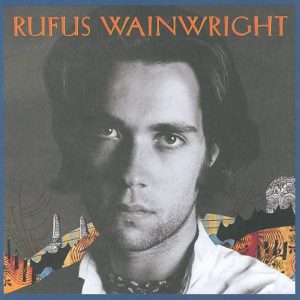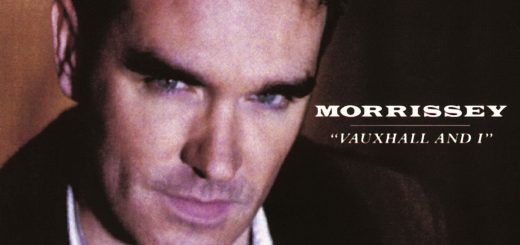Martha, my dear
Martha Wainwright Martha Wainwright (2005, Zoe Records)
Dans la famille Wainwright, on connaissait – enfin, pour être franc, surtout de nom – le papa Loudon et la maman Kate McGarrigle (qu’on évoquait par ici récemment). On connaissait principalement le grand frère, le (souvent) formidable Rufus, dont on continue d’admirer sans réserve les premiers opus parus au tournant de ce siècle. Avec ce premier album paru en 2005, on apprenait à connaître la sœur (ou la fille, selon le point de vue). Et on en venait à croire le talent affaire seulement de génétique…
Née à Montréal, Martha Wainwright passa au vu de son ascendance ses premières années immergée dans la musique. C’est peut-être pour cela qu’elle semble avoir hésité à “entrer dans la carrière”, commençant d’abord de suivre des cours d’art dramatique à sa sortie du lycée. Bien vite rattrapée par ses chromosomes, la jeune Martha se produit dès 1997 dans les clubs de sa région, ses propres compositions sous le bras. C’est derrière son frère qu’on la remarque d’abord (à peine), Martha assurant une partie des chœurs de Rufus sur son fabuleux premier album solo. Après diverses expériences – dont une comédie musicale – , Martha Wainwright fait finalement paraître ce premier album éponyme en 2005.
Comme son frère, Martha Wainwright saisit d’abord par la singularité de son chant. A l’instar de Rufus, la demoiselle est dotée d’un organe lui ouvrant une imposante gamme de possibles, dont elle sait elle aussi parfaitement user, en force ou en finesse, entre raucité et tendresse. Mais là où le frangin se frotte à d’audacieuses instrumentations tout droit sorties des musicals de Broadway, du cabaret ou de la musique classique, Martha Wainwright adopte une tonalité pop-folk moins tête brûlée. Excellemment produites, ses chansons brillent par leurs arrangements subtils, déposant entre les plis d’arpèges de guitare acoustique quelques accords de piano, une touche de harpe ou de violoncelle. Mais, sous ces atours confortables, le disque se révèle bien plus épineux qu’on pourrait le croire. Martha Wainwright cèle dans cet écrin classieux des fêlures béantes comme des crevasses, une mélancolie et un mal de vivre d’autant plus troublants qu’ils sont exprimés par une femme de près de 30 ans qui a passé l’âge de jouer à s’inventer des états d’âme.
Dès le somptueux Far away introductif, Martha Wainwright assène cette confession bouleversante : “I’ve got no children / I’ve got no husband / I’ve got no reason / To be alive again”. Et le morceau se dévide ainsi, tout de volutes fantomatiques chargées de mélancolie. On retrouve ces vérités dérangeantes à plusieurs reprises au fil du disque, sur le magnifique TV show (“I’m not such a good lover / I’m a better talker / So when you touch me there / I’m scared that you’ll see / Not the way that I don’t love you / But the way that I hate myself”) comme sur l’un des sommets de ce disque brûlant, l’ahurissant Bloody motherfucking asshole, règlement de comptes sanglant asséné à la face de son propre père – apparemment pas toujours exemplaire. On n’avait pas entendu pareil climax de tension familiale depuis l’insurpassable Daddy’s on Prozac du trop méconnu Joseph Arthur. Martha Wainwright excelle dans les ballades tendues de velours rouge (These flowers, Don’t forget) mais sait aussi briller avec des morceaux légèrement plus rythmés comme G.P.T. ou le séduisant When the day is short. Impossible également de passer sous silence l’exceptionnel Factory, pour son lent ressac qui s’échoue sur nos cœurs, et pour ces quelques mots qu’on s’est si souvent entendu penser : “These are not my people / I should never have come here”. A noter enfin pour ceux qui pourraient se procurer la version de l’album avec les bonus tracks une reprise belle à pleurer du Dis quand reviendras-tu? de Barbara…
Martha Wainwright a depuis sorti deux autres albums I know you’re married but I’ve got feelings too en 2008 – plus rutilant mais moins charmant – et un album entier de reprises de Piaf, Sans fusils, ni souliers, à Paris en 2009.