Rock and folk
Led Zeppelin III (1970, Atlantic)
Led Zeppelin – Led’ Zep’ pour les intimes – ne présente pas à première vue de quoi charmer les garçons sensibles, amateurs de mélodies fines et d’orchestrations racées. Avec son chanteur engoncé dans son moule-burnes beuglant d’une voix de poissonnière, des coupes de cheveux comme autant d’hommages grotesques au balai espagnol, et surtout cette horrible descendance heavy metal nous abreuvant depuis maintenant bientôt quarante ans de soli gluants vomis sur des rythmiques pachydermiques, Led Zeppelin pourrait rester confiné à son image caricaturale de dinosaure rock, de ceux que les punks entendaient envoyer pourrir aux oubliettes de l’histoire. J’avais moi-même consciencieusement remisé mes disques du groupe dans les tréfonds de ma discothèque, après les avoir profondément aimé à l’orée de ma vie de jeune homme. Ressortir le dossier Led Zep des cartons aujourd’hui, à un âge presque double de celui d’alors, pourrait passer pour une pathétique rechute jeuniste, première étape avant inscription aux concours de air guitar.
Mais, derrière la figure totémique d’ “inventeur du heavy metal”, Led Zeppelin affiche bien d’autres atouts dans sa manche. En proposant du blues une version électrisée gonflée de testostérone – à la manière d’Hendrix mais sans l’apesanteur – le quatuor anglais sidéra les foules à la toute fin des années 1960, semblant incendier dans le chaos de ses guitares cette fameuse (fumeuse?) innocence qui semblait avoir bercé la richesse musicale impensable de cette époque. Après deux premiers albums (I et II tous les deux sortis en 1969) creusant ce filon de plomb, Jimmy Page et sa bande amorçaient avec ce troisième opus un virage révélant les influences folk du combo, ce folk britannique porté haut par Fairport Convention ou Bert Jansch, baigné d’effluves médiévales semblant nimber cette musique d’une fascinante étrangeté.
Le groupe ne remise pas pour autant au garage ses démonstrations de force, et le riff belliqueux du martial Immigrant song (comme un Quand on arrive en ville vraiment menaçant) pourrait bien être un de leur plus beaux coups de force. Led Zeppelin livre aussi un de ses plus épatants morceaux de bravoure avec Since I’ve been loving you, blues reptilien pour cœurs brisés, qui pourrait sans cesse virer au ridicule mais emporte la mise à chaque écoute, le long de ses sept minutes bouillonnantes. Les moments les plus fascinants de l’album résident cependant dans les faux calmes inquiétants de Friends – comme une annonce des tendances orientalisantes de leur futur Kashmir – ou dans les paysages brouillés de Hats off to (Roy) Harper. Led Zeppelin baisse ainsi la garde à plusieurs reprises et se laisse aller à dériver sur un air de country (Tangerine) ou nous emmène dans la folle sarabande de Gallows pole. Cette fièvre dansante prend possession du groupe une nouvelle fois sur Bron-y-aur stomp, Led Zeppelin semblant alors se téléporter dans les années trente, dans un saloon poisseux de La Nouvelle Orléans.
Avec l’album suivant, le groupe explosera davantage encore les compteurs, approfondissant le sillon médiéval pour le tirer vers une imagerie mystique teintée de new age. Ce sera la poursuite du décompte avec IV et l’éternel Stairway to heaven. Led Zeppelin poursuivra son aventure le long des années 1970, et d’autres ont raconté cette histoire mieux que moi, qui n’en connaît qu’une parcelle (cf. François Bon par exemple). J’y reviendrai sans doute ici à l’occasion.




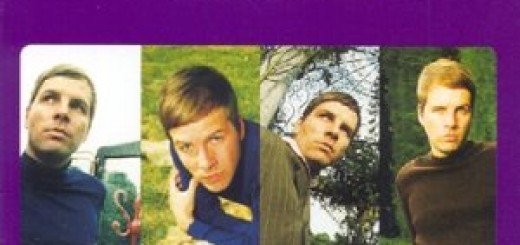


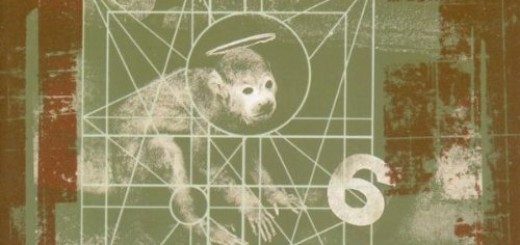
1 réponse
[…] tradition folk, elle s’abreuve autant à son affluent britannique (de Fairport Convention au troisième album de Led Zeppelin, cf. l’inaugural et hanté « Devil’s spoke ») qu’à la […]