L’oiseau moqueur
Baby Bird Fatherhood (1995, Chrysalis)
Après une bonne quinzaine d’inactivité du fait de vacances bien méritées (même si je vous ai quand même gratifié d’une petite playlist dimanche dernier), revenons aujourd’hui aux affaires le temps d’un flash-back 20 ans – mon Dieu ! – en arrière. J’ai déjà eu l’heur de causer ici-même de Baby Bird, l’alter-ego alors ultra-prolifique et aujourd’hui (me semble-t-il) bien oublié de l’Anglais Stephen Jones. J’avais pris les choses un peu dans le désordre, en commençant par aborder son There’s something going on de 1998 puis Bad shave (1995) ; je m’aperçois que je renoue ce soir le fil de sa discographie puisque Fatherhood fait directement suite à l’album susnommé.
Touch thumbs and it becomes, two bright suns in the same sky / Bad blood lighting the floor with red dye / Spreading so slowly over God’s eyes
Bad blood
Rappelons rapidement le contexte de cette année 1995. Pendant qu’Oasis et Blur se livrent à un ridicule concours de quéquettes et que dans leur foulée la brit-pop déverse quelques bons groupes et beaucoup de mauvais, un trentenaire de Sheffield dévoile au monde un ahurissant répertoire composé frénétiquement depuis plusieurs années sur son 4-pistes maison et enquille comme qui rigole quatre albums remarquables en à peine 6 mois. Troisième étage d’une fusée qui allait le conduire à décrocher la timbale un an plus tard avec Good night et surtout You’re gorgeous, Fatherhood se révèle à mon sens encore plus intéressant que son prédécesseur, le kaléidoscopique Bad shave.
We are not cool, we are not crazy / We only steal cars, because we’re lazy / We are not good, we are not bad / We only burn down houses to make us sad
Cool & crazy thing to do
Sur la pochette, Stephen Jones arbore l’air goguenard un magnifique ventre rond, évidente référence à la paternité évoquée dans le titre de l’album. On pariera cependant volontiers que cette vénérable bedaine devait sans doute davantage à quelques hectolitres de boisson houblonnée. Toujours est-il que Baby Bird aborde cet album le ventre bien rempli, rempli de morceaux pop bancals et pourtant impeccables, bricolés sur des instruments de fortune mais avec une économie de moyens proportionnelle à l’opulence des idées. Stephen Jones confirme qu’il est bien un maître artisan de la chose pop, capable de tailler de véritables pépites avec le matériel le plus fruste. Et alors que la brit-pop d’alors se complait à sucer jusqu’à la moelle l’héritage des anciens, Baby Bird compose une pop à la généalogie bien moins lisible, assemblant comme bon lui semble des matériaux qui semblent n’avoir trouvé naissance que dans son seul cerveau. C’est pourquoi il est si difficile de citer ici des références et des influences : des Beatles à Jesus & Mary Chain, de Bacharach à Beck en passant par le post-punk, on trouve beaucoup de choses dans le nid de cet oiseau moqueur, pie voleuse qui se serait construite un abri de bric et de broc avec tous les objets brillants qu’elle aurait pu chaparder.
All the love in the world / Won’t make things better
Saturday
Au final, Fatherhood m’apparaît plus cohérent que Bad shave, dans une tonalité néanmoins plus sombre. Certes, Stephen Jones a toujours laissé transparaître d’impressionnantes fêlures à son plafond mais les chœurs chatoyants qui ouvrent l’album sur No children ne seront finalement que des trompe-l’œil. La plupart des morceaux navigue dans des eaux intranquilles, Baby Bird s’y entendant comme pas deux pour faire naître un diffus sentiment de malaise dans ses morceaux, par les mots qu’il emploie, les mélodies ou le ton de sa voix (parfois par tous ces éléments à la fois). Le garçon réussit en tout cas, dans la plus pure tradition de la meilleure lo-fi, d’habiller de rien des chansons formidables, tour à tour tendues, cafardeuses, vicelardes, bravaches ou glorieuses. On le verra donc déambuler en mauvais garçon désinvolte et vaguement inquiétant sur Cool and crazy thing to do avant de le croiser en pleine ascension ouatée sur le superbe I was never here. Baby Bird se révèle ici aussi à l’aise dans les tons bleu nuit joliment chatoyants de Good weather ou Dustbin liner que dans la noirceur et la gravité mélancolique de Bad blood ou Failed old singer. Chez Stephen Jones, les chansons d’amour d’apparence les plus innocentes semblent toujours masquer de la perversité (Saturday) et les mélodies les plus diaprées cèlent des monstres et des fantômes (le génial I don’t want to wake you up). Parmi les sommets du disque, on n’oubliera pas de mentionner le formidable Aluminium beach et son “wonderful balloon” qui nous fait décoller bien haut ni l’espiègle et minimaliste Good night, dans une version épurée assez loin de la bombinette pop qu’elle deviendra. L’album se termine par une ultime pirouette avec le récréatif May we (qu’on pourra aussi lire “Mais oui”) sur lequel Baby Bird se paie d’un étonnant et burlesque refrain en français sur une mélodie bancale et pourtant fortement addictive.
Little bird that sings, watch me on the swings / You’re too small to fly, but I wish I had your wings / Little girl that swings, watch me through your fingers / Holding on like murder, to this failed old singer
Failed old singer
Il me reste encore quelques albums de Baby Bird à découvrir, le garçon ayant au final eu une carrière assez chaotique, à tel point que j’ai du mal à cerner où il en est aujourd’hui. Il semble que le dernier album en date de Baby Bird soit paru en 2011 et s’intitulait The pleasures of self destruction mais je sais que Jones a multiplié les projets et participations, sortant des disques sous son nom aussi bien qu’avec d’autres groupes. J’essaierai de démêler tout cela à l’occasion et peut-être de vous reparler de ce drôle d’oiseau une autre fois.

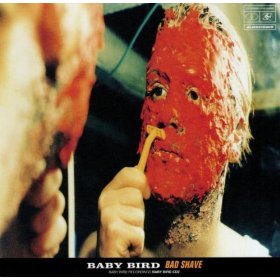
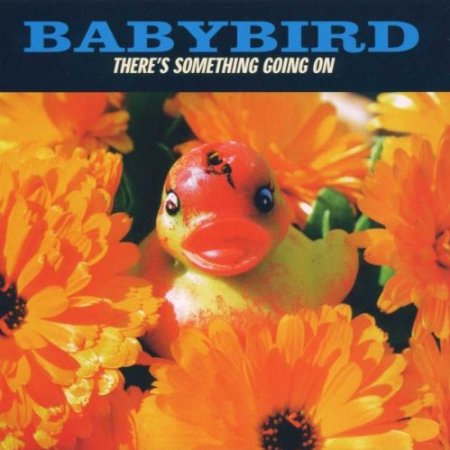
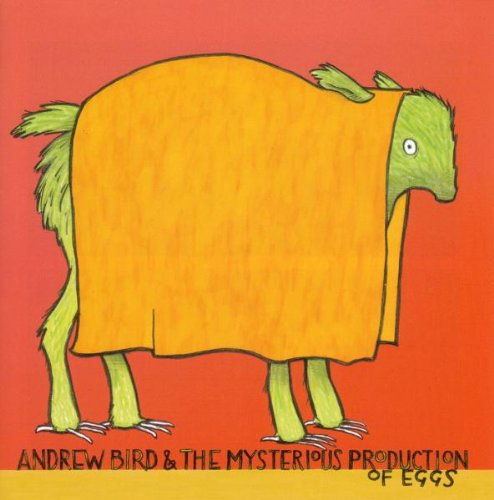




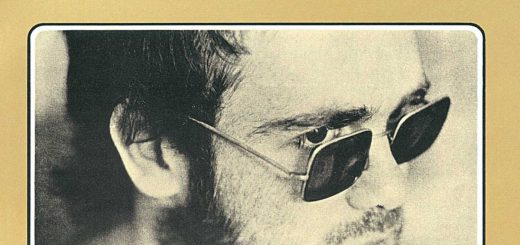

1 réponse
[…] ces impressions. Après Bad shave, Stephen Jones sortit dans la foulée l’excellent Fatherhood puis The happiest man alive (1996 – que je ne connais pas) avant de décrocher un contrat […]