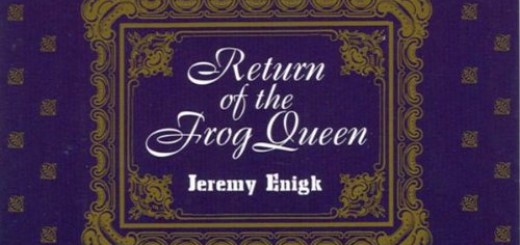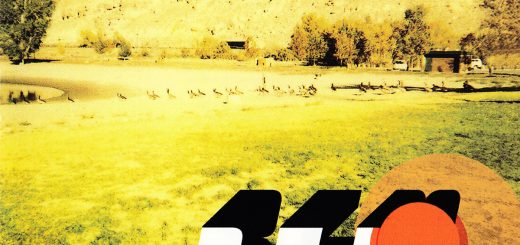L’alchimiste
Jeffrey Lewis 12 Crass songs (2007, Rough Trade)
Né en 1975 à New York, Jeffrey Lewis se passionne dès son plus jeune âge pour la bande dessinée et la musique, dévorant d’abord les disques de blues de son père avant de se passionner à l’adolescence pour Grateful Dead ou Nirvana. En 1998, il enregistre une cassette qu’il accompagne d’une de ses bandes dessinées. Ce premier enregistrement arrive (via les Moldy Peaches) dans les bureaux du label Rough Trade qui signe le jeune homme pour un premier album, The last time I did acid I went insane and other favorites, qui paraît en 2002. Ce premier album (que je ne connais pas) le rattache clairement à la scène dite antifolk, scène souhaitant mêler l’esprit punk (engagement politique, autodérision…) à une musique essentiellement acoustique.
Deux albums après son premier opus, Jeffrey Lewis entreprend sur ce 12 Crass songs de reprendre (comme le titre l’indique) douze chansons du groupe punk anarchiste anglais Crass, combo sévissant au tournant des années 70 et 80. Ultra politisé, Crass délivrait tels des parpaings des brûlots punk, aussi radicaux dans leur propos qu’assourdissant sur la forme. J’avoue n’avoir écouté de titres du groupe qu’après avoir écouté les reprises de Jeffrey Lewis: s’il n’est pas nécessaire de connaître les originaux pour apprécier les interprétations de Lewis, un détour par les versions primitives permet de se rendre davantage compte du tour de force du bonhomme.
Jeffrey Lewis fait en effet subir un étonnant ravalement de façade au bunker bâti par le groupe anglais. Il transforme ainsi le plomb des brûlots originaux, postillonnant à la face de l’Angleterre thatchérienne leur haine du système et leurs convictions anarchistes, en dorures finement ciselées, reposant sur les atours traditionnels de la grande geste folk: guitares acoustiques en liberté, arrangements subtils… Avec tout cela, il parvient à ne pas perdre une once de la puissance contestataire des originaux, qui passe d’autant mieux qu’elle n’est pas enfouie sous une tonne de bruit blanc.
De ces 12 excellentes reprises, on pourra retenir en premier lieu l’introductif End result, où la guitare de Lewis dévale de somptueux arpèges tandis que de vibrants arrangements emplissent l’atmosphère. Sur I ain’t thick, it’s just a trick (meilleur morceau de l’album) , on a l’impression d’entendre un étonnant duo anar qui aurait viré Nick Drake de devant le micro durant les sessions de Bryter layter. Lewis demeure fidèle à la geste antifolk avec ces merveilles à la fois enjouées et engagées que sont Do they owe us a living? ou Securicor. Difficile aussi de passer sous silence le génial Punk is dead, interprété ici comme une douce élégie, éloge funèbre prononcé sur le cercueil du punk par un de ses héritiers doués. L’impressionnant Big A, little A, seul titre sur lequel les guitares électriques prennent le pouvoir, nous renvoie en mémoire les bombes incendiaires des regrettés Diabologum, rien de moins.
Sur l’ensemble du disque, le chant nasillard de Lewis, parfaitement entouré notamment par la voix de Helen Schreiner, fait merveille, apportant un étonnant mélange de détachement et de naïveté à l’ensemble. Avec ses crayons de couleur et ses outils à lui, Jeffrey Lewis a donc remarquablement refait le portrait des enragés de Crass, redonnant tout son sens à la notion de reprise, apportant son originalité et ses talents d’architecte pour construire autre chose à partir de plans identiques. Du grand art…