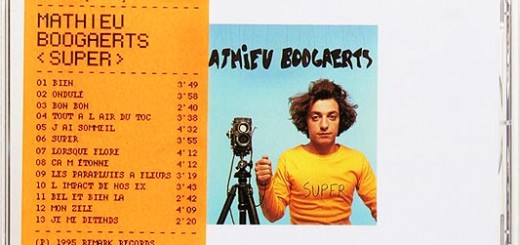Lady Marianne
Marianne Faithfull Broken English (1979, Island)
Le visionnage du remarquable portrait de Marianne Faithfull, Fleur d’âme, réalisé par Sandrine Bonnaire et récemment diffusé sur Arte m’a donné envie de réécouter quelques-uns des albums de la dame et me voici ce soir à vous parler de ce disque généralement considéré comme son meilleur. Son meilleur je ne sais pas mais certainement le plus emblématique du caractère, du talent et de la capacité de résilience de Lady Marianne. Car Broken English est un disque de rescapée, un flamboyant retour de flamme comme le rock en produit parfois. On pourrait ainsi le rapprocher de l’éclatant come-back d’une autre tête brûlée notoire : Iggy Pop, qui deux ans avant Marianne Faithfull, revenait à la vie avec le formidable diptyque The idiot / Lust for life.
Got so much to offer, but I can’t pay the rent / I can’t buy you roses ’cause the money’s all spent
Brain drain
Rien ne laissait pourtant présager en 1979 que Marianne Faithfull reviendrait ainsi sur le devant de la scène. Lancée à 18 ans tout juste par le madré Andrew Loog Oldham comme une sorte de correspondante anglaise à notre Françoise Hardy, Marianne Faithfull devint bientôt une figure de proue sulfureuse du Swinging London, embarquée aux bras de Mick Jagger dans le grand cirque chaotique des Rolling Stones. A partir de 1970, son existence allait progressivement virer au cauchemar, plombée par des addictions mortifères et divers coups du sort. Elle vécut ainsi plusieurs années durant entre la rue et les squats londoniens, la sortie en 1975 du confidentiel Dreamin’ my dreams ne constituant qu’une faible lueur dans ce paysage désolé. C’est finalement sa rencontre avec Barry Reynolds en 1976 qui allait marquer le point de départ de sa résurrection. Avec ce nouveau partenaire de jeu, elle réalise les démos de Broken English et Why’d ya do it, démos qui séduiront suffisamment Chris Blackwell, le patron du label Island, pour qu’il lui propose un contrat.
Her husband, he’s off to work / And the kids are off to school / And there are, oh, so many ways / For her to spend the day / She could clean the house for hours / Or rearrange the flowers / Or run naked through the shady street / Screaming all the way
The ballad of Lucy Jordan
Broken English paraît à la fin de l’année 1979 et témoigne d’une renaissance artistique aussi impressionnante qu’inespérée. Loin de la pop gracile de ses succès des années 1960, c’est une Marianne Faithfull marquée par les épreuves et revigorée par le souffle de l’ouragan punk et new-wave qui revient avec rage et brio. Elle semble libérer la frustration accumulée depuis ses débuts et laisser libre cours à ses talents de songwriter longtemps gardés dans l’ombre écrasante de la paire Jagger-Richards, qui aura d’ailleurs du mal à reconnaître que la dame Faithfull était bien co-autrice du formidable Sister Morphine qui venait clore tout en beauté vénéneuse Sticky fingers. L’album s’avère au final assorti aux couleurs de sa magnifique pochette, entre bleu nuit et rouge incandescent. La voix de Faithfull, abîmée par des années d’abus, se révèle un atout insoupçonné et confère à ses chansons une patine douce et râpeuse porteuse de mille expériences. Musicalement, Broken English touche à différents styles (pop, rock, reggae, une dose de soul) mais ce sont bien les sonorités synthétiques de la new-wave qui habillent les deux morceaux-phares de l’album, Broken English et The ballad of Lucy Jordan. Le premier ouvre l’album comme une déflagration, avec sa rythmique pulsative (annonciatrice du Reflektor d’Arcade Fire), ses zébrures électriques, ses gargouillis électroniques, soulignés de nappes de synthé menaçantes parfaitement adaptées à une chanson qui parle de terrorisme politique dans un climat de guerre froide. Cette entrée en matière abrupte marque le retour au monde de Marianne Faithfull, et il sera offensif et ardent, Lady Marianne en ayant fini depuis bien longtemps d’être muse. The ballad of Lucy Jordan, reprise d’un morceau composé par Shel Silverstein, sera le succès qui couronnera le retour en grâce artistique de Faithfull d’un renouveau commercial. Étonnant d’ailleurs qu’une chanson qui parle de la tentative de suicide d’une femme au foyer accablée par l’ennui ait pu compter autant de passages radio, la faute sans doute aux papillons noirs qui volètent sans cesse autour de l’interprétation habitée de Marianne Faithfull. Broken English recèle cependant d’autres pépites que ces deux morceaux fameux. Je pense par exemple au blues gouailleur de Brain drain ou à ce Guilt rocailleux, aux faux airs de Stevie Wonder secoué par le col. Marianne Faithfull place aussi une reprise glaciale et glaçante du Working class hero de John Lennon et l’album se termine sur ce Why’d ya do it furibard, sorte de reggae électrifié sur lequel Faithfull éructe une bordée d’insanités à faire rougir la jeunesse punk. Les guitares déchirent et portent le morceau d’un même mouvement et Faithfull trouve un parfait exutoire à sa colère dans ce raout bouillonnant.
I never gave to the rich / I never stole from the poor / I’m like a curious child / Give me more, more, more
Guilt
Avec Broken English, Marianne Faithfull signait un véritable disque de survivante et réussissait, ironie de l’histoire, à attraper en marche le train de la modernité que nombre de ses compères de l’époque étaient en train de rater, bousculés par la déferlante punk qui s’était abattue sur le rock en 1977. Remise sur pied artistiquement et financièrement, il lui faudra encore quelques années encore pour tirer un trait sur ses addictions. Elle mène depuis une carrière riche et remplie, en tant que chanteuse et musicienne, mais aussi en tant qu’actrice, au théâtre ou au cinéma. Elle livre régulièrement des disques souvent fort recommandables, tels par exemple Kissin’ time dont j’ai parlé dans les tout débuts de ce blog ou le très bon Before the poison.